[Page principale | Nouveautés | La Bible | la Foi - l'Évangile | Cantiques]
Récits de l’Empire du Milieu
Willis A. F. et G. C.
1° édition en français : 1934
Table des matières :
2 Quelques histoires de petit chinois
2.1 « Heureuse » ou Sauvée de la mort
2.4 « AH SLOU », ou Le prix de la Rançon
2.7 « KUM TAÏ » ou les habitants des bateaux, en Chine
3.3 Un jeune chinois à l’étranger
3.4 La prédication d’un jeune garçon
3.6 Une histoire vraie où il est question d’un tigre
3.9 Le diseur de bonne aventure
3.10 Jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé
4 Quelques histoires de brigands
4.2 Rachetés à la dernière heure
4.3 Comment Leang Choi Fung se comporta avec les brigands
Les histoires réunies dans ce petit livre ont été écrites par un missionnaire et par les membres de sa famille et traitent de choses qu’ils ont vues et entendues.
Leur premier but est de présenter Christ, et le salut par Lui ; mais les histoires et les illustrations offrent aussi un tableau fidèle de la vie dans certaines parties de la Chine. Et l’ardent désir et la prière des auteurs de cet ouvrage est qu’il soit un moyen, non seulement d’amener des pécheurs au Sauveur, mais encore d’engager quelques enfants de Dieu, jeunes et vieux, à « lever leurs yeux et à regarder les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson ». Et le Seigneur ajoute : « Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle ». Qu’avez-vous fait jusqu’ici pour le Maître qui vous a racheté ?
J’ai pensé que j’aimerais raconter aux enfants d’Europe quelque chose de nos petits amis qui habitent ce grand et lointain pays qu’on appelle la Chine.
En réalité, ces petits Chinois ne sont pas tellement différents de vous, et Je suis sûr que vous les aimeriez beaucoup si seulement vous pouviez les connaître. Mais comme vous ne pouvez pas venir les voir ici, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, en vous racontant des histoires à leur sujet.
Tout d’abord je veux vous dire une ou deux des raisons pour lesquelles je désire vous parler d’eux. La première est que je sais que quelques-uns d’entre vous connaissez le Seigneur Jésus pour vous-mêmes ; vous l’aimez et vous le priez ; et je voudrais que dans vos prières vous vous souveniez des petits enfants jaunes et que vous priiez aussi pour eux. Rappelez-vous qu’ils ont des âmes précieuses tout comme vous et qu’ils ont besoin d’un Sauveur aussi bien que vous ; mais rappelez-vous aussi que beaucoup, beaucoup d’entre eux n’ont jamais entendu parler de ce Sauveur, et que, parmi ceux qui ont entendu Son nom, bien peu Le connaissent réellement.
Mais il y a une autre raison pour laquelle je désire vous parler des enfants chinois, c’est parce que je crains que plusieurs de mes petits lecteurs n’aient pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur, quoiqu’ils aient entendu parler de Lui depuis si longtemps, et j’espère qu’en s’intéressant à l’histoire de nos petits Chinois ils comprendront mieux comment on peut venir au Sauveur et recevoir Son grand salut.
Il y a tant d’enfants dont j’aimerais vous parler que je sais à peine par où commencer, mais je pense que notre petite « Heureuse » a les premiers droits à venir vous faire visite ; ainsi vous allez écouter son histoire et tâcher de la voir en imagination.
Il y a trois ans, une vieille femme apporta à notre porte un drôle de petit paquet enveloppé dans une paire de pantalons usés et nous pria de le prendre — non pas de prendre les pantalons, elle voulait les remporter, mais ce qu’ils entouraient, et que pensez-vous que c’était ? Un bébé chinois, une petite fille dont ses parents voulaient se débarrasser ! La vieille femme ne désirait pas sa mort, c’était un si joli bébé ! Ainsi elle l’avait apporté chez nous pour voir si nous consentirions à le garder. Nous l’avons donc prise, et maintenant ce drôle de petit paquet est devenu une chère petite fille de trois ans.
Je voudrais que vous puissiez voir notre petite « Heureuse » dans ses vêtements chinois en coton bleu foncé, longs pantalons et petite veste courte, avec ses pieds nus dans des souliers de bois. Elle a des yeux noirs brillants à l’expression joyeuse, d’abondants cheveux noirs assez courts, une petite figure brune toute ronde avec un drôle de petit nez aplati, et tous ses compatriotes l’admirent beaucoup. Pour nous, elle est un vrai rayon de soleil. En ce moment il fait un froid de « six vêtements », comme on dit ici, et elle est si bien enveloppée qu’elle paraît aussi large que haute.
De combien peu elle a échappé à la mort ! Il y a tant, tant de fillettes qui périssent dans ce pays ! Dans une maison qui est à quelques pas de la nôtre, les parents ont noyé deux petites jumelles parce qu’ils n’en voulaient pas ! Mais cette chère petite « Heureuse » a trouvé un sauveur, quelqu’un qui pouvait et voulait la délivrer de la mort. Et savez-vous, chers enfants, que nous qui vivons dans d’autres pays, nous avons besoin d’un Sauveur divin. Il fallait à la petite « Heureuse » un sauveur qui délivrât son corps de la mort, mais nous avons besoin d’un Sauveur qui délivre nos âmes de la seconde mort dans l’étang de feu.
Où rencontrerons-nous un tel Sauveur ? Il est très difficile de trouver un sauveur pour les petites Chinoises, et des milliers d’entre elles périssent chaque année faute d’en avoir un, mais est-il très difficile pour vous et moi de trouver un Sauveur ?
« Ah ! » direz-vous, « non, ce n’est pas difficile, Jésus est notre Sauveur ».
Oui, vous avez raison. Mais laissez-moi vous demander s’Il est votre propre Sauveur ? Vous a-t-Il sauvé, vous ? Pour « Heureuse », c’était maintenant ou jamais, et pour vous cela peut être aussi maintenant ou jamais. Ô cher enfant, si vous n’avez pas encore trouvé le Sauveur, cherchez-le aujourd’hui, sans attendre davantage, car Lui-même a dit : « Ceux qui me recherchent me trouveront » (Prov. 8:17).
Lorsque Heureuse avait environ deux ans et demi, on nous a apporté un autre bébé dans l’espoir que nous le prendrions, et c’est ce que nous avons fait naturellement. C’était un pauvre petit être dont personne sur la terre ne voulait ; aussi l’avons-nous appelée « Don du ciel ». Il est doux de penser que le Seigneur Jésus aime ces pauvres petites abandonnées si même leurs parents n’ont point d’affection pour elles. Oui, je suis sûr qu’Il aime chacune d’elles exactement de la même manière qu’Il nous aime, vous et moi, et lorsque vous entendez parler de ces malheureuses fillettes, il vous faut essayer de les aimer aussi pour l’amour du Seigneur Jésus.
« Don du ciel » est encore un très petit être, et je l’appelle souvent « Deedeeco », ce qui signifie « petite », mais elle est intelligente et robuste quoique au début sa vie ait paru bien fragile. Elle a des yeux noirs et nous regarde curieusement, comme si elle se demandait pourquoi nous sommes différents des autres gens qui l’entourent. D’abord elle avait grand peur de nous ; notre teint clair la surprenait, mais maintenant elle s’est habituée à nous et commence à éprouver de l’attachement pour la personne qui prend soin d’elle. Cependant si vous lui rendiez visite et cherchiez à la prendre dans vos bras comme vous feriez d’un autre bébé, je crois qu’elle pousserait des cris de terreur jusqu’à ce que quelque Chinoise bienveillante vienne à son secours.
Ces deux petites filles, « Heureuse » et « Don du ciel » vivent avec nous et nous les considérons comme de précieux trésors que nous avons la tâche d’élever pour le Seigneur Jésus. Et maintenant je voudrais vous demander de prier que, si le Seigneur tarde encore, ces petites filles grandissent pour suivre fidèlement le Sauveur et puissent en temps voulu parler à leurs compatriotes d’un meilleur « don du ciel », le Don inexprimable de Dieu.
Combien souvent n’avez-vous pas entendu l’histoire du petit enfant qui vint dans ce monde il y a plus de dix-neuf cents ans, comme l’Envoyé de Dieu. Quelques personnes furent très heureuses de le voir, mais la plupart des gens ne se souciaient pas de lui, et il ne se trouva même pas de place pour Lui et sa mère dans l’hôtellerie. Ils durent demeurer dans une étable. Certains hommes haïssaient ce petit enfant et cherchèrent à le faire mourir, mais Dieu prit soin de Lui et Il grandit pour devenir un homme. C’est une histoire que vous connaissez depuis longtemps. Vous savez bien qu’il s’agit de Jésus, mais ici, en Chine, il y a des millions de personnes qui n’ont jamais entendu ce précieux Nom.
Oui, JÉSUS est le don le plus merveilleux que Dieu pouvait nous faire. N’avez-vous pas souvent entendu cette parole : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ? » Nous pouvons bien nous écrier : « Grâces à Dieu pour son don inexprimable ! »Mais, chers enfants, laissez-moi vous demander si vous avez jamais accepté le don de Dieu ? Cette petite Chinoise était un don du ciel (ou le don de Dieu) pour ma soeur, — non pour vous — mais le Seigneur Jésus est le don de Dieu pour vous, pour vous-même. Que faisons-nous lorsqu’un don nous est offert ? Nous tendons la main pour le prendre et nous disons : « Merci ». Il ne devient nôtre que lorsque nous l’avons accepté. « Don du ciel » n’appartint à ma soeur que lorsque celle-ci l’eut prise dans ses bras pour la garder toujours. Il y a beaucoup de bébés que nous n’avons jamais pu recueillir et ils n’ont jamais été à nous. Mais lorsque nous avons accepté « Don du ciel », elle nous a appartenu en propre. Il en est ainsi du Seigneur Jésus. Qu’avez-vous fait de Lui ? L’avez-vous accepté ? Ou bien avez-vous dit en votre coeur : Oh ! j’ai bien le temps, j’y penserai un autre jour ? Si aujourd’hui il n’est pas encore votre Sauveur, ne voulez-vous pas l’accepter maintenant et recevoir de Lui le salut et la vie éternelle ?
« Le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur » (Rom. 6:23).
Aujourd’hui je vais vous parler d’Ing, la fillette d’une dame qui donne des leçons dans notre école.
Ing a sept ans, mais elle n’est pas grande pour son âge. Elle a une petite figure brune, des yeux noirs, et deux minuscules tresses attachées d’un cordon rouge. Elle marche presque toujours nu-pieds, et a une manière de vous regarder pensivement qui vous serre le coeur. Mais lorsque vous connaîtrez son histoire, vous comprendrez mieux son regard triste.
Quand Ing était petite, sa mère n’enseignait pas encore dans notre école, et elle était extrêmement pauvre ; il lui était presque impossible d’acheter de la nourriture pour elle-même et sa famille de trois enfants. À la fin elle décida qu’elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi et qu’il lui fallait se séparer d’un des enfants. Ce ne pouvait naturellement pas être son seul fils ; sa fille aînée lui rendait déjà bien des services ; et ainsi il se trouva que la plus jeune, la petite Ing, fut donnée par sa mère à des étrangers.
Ce fut une dure épreuve pour la pauvre femme, et la petite fille en eut le coeur brisé. Ah ! mes enfants, vous connaissez ou vous appréciez peu les grâces que vous avez reçues de Dieu : une nourriture abondante, une demeure confortable, de chauds vêtements ; et jamais vous n’avez connu la moindre crainte d’être vendus par vos parents. Mais, triste à dire, tous les enfants ne sont pas aussi privilégiés que vous ; cependant peut-être n’y avez-vous jamais pensé ou n’avez-vous jamais remercié Dieu de vous avoir ainsi comblés de ses bienfaits.
Le coeur de la pauvre mère saignait en pensant à sa petite fille, et l’enfant ne pouvait se consoler. La mère était une chrétienne, et les gens auxquels elle avait donné sa fillette étaient païens. Elle réalisa, mais un peu tard, que sa petite fille serait élevée dans le culte des idoles, sans la connaissance du Sauveur et de son amour, n’ayant pas l’espérance de la vie éternelle. Plus la pauvre mère réfléchissait à ces choses, plus la pensée du sort réservé à son enfant lui devenait intolérable, et à la fin, désespérée, elle vint raconter son histoire à ma soeur.
Or, il se trouvait que, précisément à ce moment, un ami d’Amérique avait envoyé une certaine somme à ma soeur, et avec cet argent elle put racheter la petite Ing. Oh ! quel bonheur pour la mère lorsqu’elle put serrer son enfant dans ses bras avec l’assurance qu’elle lui appartenait de nouveau ! Et la petite fille se suspendait au cou de sa mère, à la fois heureuse de la revoir et terrifiée à l’idée qu’on pourrait l’emmener encore une fois. Laquelle des deux éprouvait la plus grande joie ? je pense que c’était peut-être la mère.
Et maintenant, savez-vous à qui cette histoire me fait penser ? Eh bien, à vous et à moi. Nous étions perdus, « vendus au péché », sous le pouvoir de Satan, et nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes de l’éternité de malheur qui nous attendait. Alors le Seigneur Jésus est venu et nous a rachetés, exactement comme la petite Ing, seulement Lui n’a pas donné pour nous de l’or ou de l’argent, mais il a versé son précieux sang. L’en avez-vous jamais remercié ?
Dieu nous dit dans sa Parole : « Vous n’êtes pas à vous-mêmes ; car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Oui, le prix a été entièrement payé ; de même que ma soeur avait payé la somme nécessaire pour racheter la petite Ing, le Seigneur Jésus a déjà payé tout ce qu’il fallait pour vous racheter. Si la petite Ing avait dit : « Oh ! je ne crois pas que le prix ait été payé pour moi, je ne puis pas retourner chez ma mère », vous diriez : « Quelle stupide enfant ! Elle devrait le croire, du moment qu’elle sait qui a payé le prix, et se réjouir de revenir librement à la maison ». Oui, naturellement, c’est ce qu’elle devait faire et c’est ce qu’elle a fait ; mais qu’en est-il de vous ? Vous êtes dans une situation encore pire que celle de la petite Ing, vous êtes perdu, sous le pouvoir de Satan, mais le prix a été entièrement payé, et Dieu lui-même qui ne peut mentir, vous annonce que maintenant vous êtes libre et pouvez venir à Jésus. Ne voulez-vous pas le croire, venir à Lui avec joie et Le remercier ?
Plusieurs mois après avoir écrit cette histoire, j’ai reçu une lettre m’annonçant que le Seigneur Jésus a appelé à Lui la petite Ing. Il l’avait rachetée par son précieux sang, et maintenant Il l’a prise auprès de Lui puisqu’elle lui appartenait. Elle a été rachetée deux fois ; une fois avec l’argent envoyé d’Amérique, et une fois par le sang de Jésus.
Mon petit lecteur a-t-il jamais été racheté ?
Ah Slou est une fillette de trois ans et demi. Elle vivait dans un village à six ou sept kilomètres de la ville que nous habitons. Son père possédait une petite ferme, et quoiqu’il fût encore jeune, était le chef de la famille et avait la charge de pourvoir de riz un grand nombre de personnes. Le père d’Ah Slou est un chrétien, mais à l’époque dont je vous parle, il n’y avait pas longtemps qu’il connaissait le Seigneur Jésus et il n’était pas encore très ferme dans la foi. Ah Slou a une vieille grand-mère aveugle qui ne croyait pas en Jésus et adorait encore les idoles. Ah Slou prend soin d’elle et lui donne à manger, quoiqu’elle soit encore si petite.
Depuis six mois les brigands ont fait beaucoup de mal dans la région que nous habitons. Ils sont au nombre de plusieurs milliers, ils ont des fusils, viennent en bandes attaquer les villes et les villages, volent tout ce qu’ils peuvent, incendient souvent les maisons, et emmènent les habitants comme prisonniers. Le village où vit Ah Slou a été attaqué plusieurs fois, et son père a été obligé souvent d’emmener précipitamment toute sa famille passer la nuit sur les collines pour échapper aux brigands. Tout ce qu’il possédait avait été volé, et chaque fois qu’il parvenait à réunir quelques objets, ils lui étaient enlevés de nouveau. À la fin, de désespoir, tous les habitants du village se firent brigands — ils n’avaient rien à manger, aucun moyen de gagner quelque chose, et si même ils parvenaient à obtenir quelque bien, les brigands revenaient et le leur volaient de nouveau. Je suis fâché de devoir dire que le père d’Ah Slou se fit brigand comme les autres. C’était très mal à lui, mais si vous et moi avions été dans la même position, peut-être n’aurions-nous pas agi autrement. Après avoir exercé ce vilain métier pendant environ une semaine, il se sentit si malheureux qu’il décida de cesser ce genre de vie et de revenir à la ville (Je suis heureux de dire que, pendant qu’il était avec les brigands, ils n’avaient attaqué aucun village). Sur son chemin de retour à la ville, il rencontra des soldats qui l’arrêtèrent et le mirent en prison. Ses compagnons furent tous fusillés quelques jours après. Le père d’Ah Slou dut assister à l’exécution pour connaître le sort qui l’attendait. C’était très triste et nous étions tous bien malheureux. La vieille grand-mère d’Ah Slou se jeta dans un puits près de sa maison pour se noyer, mais elle fut sauvée par des voisins. Les semaines passèrent et le pauvre homme était toujours en prison, les fers aux pieds. Parfois il était malade, mais les soldats ne le traitaient pas pour cela avec plus de douceur. D’autres hommes autour de lui furent encore mis à mort, mais Dieu prit soin de lui.
À la fin nous apprîmes que, si on payait une grosse somme, il serait libéré. Mais où trouverait-on l’argent ? Tout ce que le malheureux possédait avait depuis longtemps été volé. Ses amis cherchèrent à vendre leurs terres, mais personne ne voulait acheter de propriétés dans une contrée pareillement infestée de brigands. Par différents moyens ils arrivèrent pourtant à réunir une somme minime, mais elle n’était pas suffisante. À la fin il fut décidé que la petite Ah Slou serait vendue pour compléter le prix demandé. Ce fut un terrible coup pour tous. Le pauvre père chérissait tendrement son enfant, la mère — je n’ai pas besoin de vous dire ce qu’elle ressentait — et le coeur de la pauvre grand-mère fut presque brisé, car la petite fille était toute sa joie. La petite Ah Slou comprenait très bien de quoi il s’agissait, et nous étions tous très tristes pour elle. Elle rapporta une très forte somme pour une enfant aussi jeune, et on put ainsi racheter son père. Mais à quel prix ! Sa propre enfant ! Et tout cela à cause de son péché ! Pouvez-vous imaginer ce que ressentit le père lorsqu’il sortit de prison, libre, mais avec la perspective pénible de devoir racheter sa petite fille ? Ceux qui l’ont vu à ce moment-là n’oublieront jamais son expression tandis que, tenant la petite main d’Ah Slou dans la sienne, il la regardait pensivement, sachant bien qu’il n’avait recouvré sa liberté qu’au prix de celle de son enfant.
Il ne s’agissait que d’un péché, mais quel châtiment ! Avez-vous jamais réfléchi au châtiment de vos péchés ? Peut-être pensez-vous que vous n’en avez pas commis beaucoup. Mes enfants, un seul péché suffit à vous attirer la mort éternelle. Oui, un seul péché, même si vous n’en commettiez point d’autre, vous conduira dans l’étang de feu pour l’éternité. Mais que pouvons-nous faire ? N’y a-t-il aucun moyen d’y échapper ? Que pouvait faire le père d’Ah Slou, couché dans sa prison avec les fers aux pieds ? Rien, absolument rien. Et vous ne pouvez rien faire non plus. Vous avez péché, et la mort : la mort éternelle est ce que vous méritez. Dieu dit que nous sommes sans force. Mais en dehors de la prison, quelqu’un faisait tout son possible pour sauver cet homme de la mort. Sa propre enfant se donnait elle-même et une rançon était payée pour lui. La seule chose qu’il avait à faire était de le croire. Dès l’instant où le gouverneur de la prison eut accepté l’argent, le père d’Ah Slou fut libre. Mais supposez qu’il eût dit : « Oh ! je ne puis le croire ; comment être sûr que cela me concerne, moi ? » Alors il aurait péri en sa prison, même si le prix avait été payé et accepté pour sa rançon. Il en est de même pour vous et moi. Le prix a été payé — un prix infiniment plus élevé que celui d’un petit enfant — oui, le Fils unique de Dieu est mort pour nous délivrer. Il a payé la rançon. Dieu a accepté le prix, et la seule chose que nous ayons à faire est de le croire et de Lui rendre grâces.
Mon histoire ne finit heureusement pas là. Quelqu’un qui aimait la petite fille et son père vint racheter l’enfant à un prix plus élevé et la rendit à ses parents. Quelle joie ! Mais il y eut une joie bien plus grande encore devant les anges de Dieu lorsque la vieille grand-mère crut en Jésus et fut délivrée du pouvoir de l’ennemi. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Christ a payé la rançon avec son propre sang. Dieu a accepté le prix payé. Tout est accompli. L’avez-vous cru ?
« Rachetés par le sang précieux de Christ » (1 Pierre 1:19).
Dans le chapitre précédent, je vous ai raconté quelque chose des brigands qui dévastent certaines régions de la Chine, et de la rançon qu’il fallut payer pour délivrer un homme de la mort. Nous avons aussi dit un mot du prix qui a dû être payé pour nous racheter, vous et moi, de la mort éternelle. Aujourd’hui je voudrais vous parler de quelqu’un qui paya la rançon nécessaire pour racheter un petit bébé et sa mère à ces mêmes brigands — cette personne est appelée le libérateur ou le Rédempteur.
À quelque distance de l’endroit où nous vivons, se trouve une ville commerçante nommée Daikow. Dans cette ville habitait une femme d’une cinquantaine d’années, qui portait le nom de Slaam Shaan. Son fils était un négociant dont le magasin était fort bien achalandé. Sa femme et ses trois enfants vivaient avec lui, mais ils étaient tous originaires d’un village de pêcheurs situé à quelque distance de la ville, sur un point retiré de la côte. Depuis plusieurs années, la contrée environnante avait plus ou moins souffert de la part des brigands, mais cette région avait été épargnée jusqu’ici, et les habitants, y compris Slaam Shaan et sa famille, menaient une vie facile et confortable.
Il y a environ quatre ou cinq mois les brigands se rapprochèrent de Daikow. Le négociant envoya sa mère, sa femme et ses enfants dans leur village natal qu’il jugeait moins exposé que la ville, et lui-même resta en arrière pour prendre soin de ses affaires. Peu après les brigands envahirent la ville, brûlant et pillant tout ce qu’ils rencontraient. Le fils de Slaam Shaan s’échappa du magasin au moment où la maison allait être détruite par les brigands, et chercha à gagner le village où s’était réfugiée sa famille ; mais en route il fut brutalement assassiné.
Après avoir saccagé Daikow, les brigands s’attaquèrent aux villages avoisinants, et atteignirent bientôt celui de Slaam Shaan, incendiant tout devant eux. Les habitants se réfugièrent dans une haute tour, mais ce fut en vain. La tour fut prise, une partie des malheureux furent mis à mort, et les autres, hommes, femmes et enfants, emmenés prisonniers pour n’être libérés que contre rançon. Les brigands s’emparèrent de toutes leurs possessions et laissèrent le village en ruines.
Slaam Shaan, sa belle-fille et ses petits-enfants étaient parmi les prisonniers. Au bout de quelque temps Slaam Shaan et deux des enfants furent relâchés afin qu’ils pussent travailler à obtenir la somme exigée comme rançon pour la belle-fille et le bébé. Cette somme était très élevée, et, quoique Slaam Shaan fît tout ce qu’elle pût pour trouver de l’argent, mettant ses champs en gage et empruntant de tous côtés, elle était encore loin de compte. Sa belle-soeur, une femme âgée qui avait mis de côté une petite somme pour ses vieux jours, lui céda son maigre pécule, mais malgré tous les efforts, le chiffre de la rançon n’était pas encore atteint. Au moment où on désespérait d’y arriver jamais, les brigands réduisirent soudain le prix demandé. La pauvre mère et son enfant étaient si amaigris et paraissaient si malades que les malfaiteurs craignaient de ne rien recevoir du tout s’ils attendaient davantage.
Vous pouvez bien penser que les négociations ne furent pas longues. Mais je vais vous faire lire un fragment de la lettre qui me racontait l’histoire (J’étais absent lorsque ces événements se déroulèrent).
« C’est hier que l’argent de la rançon a été prêt, et tout l’après-midi Slaam Shaan est restée assise à sa porte, attendant de recevoir l’ordre d’aller chercher sa belle-fille qui devait arriver de Haap Shaan par le bateau, avec les brigands. Tout l’après-midi elle resta là ; son visage portait une expression de joyeuse attente ; elle était trop heureuse pour parler. Cependant aucun messager n’apparaissait et sa figure s’assombrissait sous l’empire de l’anxiété et du désappointement ; à la fin la nuit vint et la pauvre femme était toujours à la même place, guettant le messager. Cela nous fit penser au Sauveur, notre précieux Seigneur, ayant la rançon toute prête et attendant que les âmes viennent à Lui. Combien son coeur désire les recevoir ! Cela fait aussi réaliser combien on peut être reconnaissant de pouvoir travailler à chercher de telles âmes pour l’amour de Christ qui les désire et les attend ».
Enfin le moment vint où il fallut fermer la porte, sans qu’aucun messager eût paru. Vous pouvez vous imaginer le chagrin de la pauvre Slaam Shaan lorsqu’elle dut rentrer seule dans sa maison.
Avez-vous jamais réfléchi, chers enfants, que bientôt, très prochainement, le Sauveur qui attend si patiemment que vous veniez à Lui, devra se lever et fermer la porte ; et que beaucoup seront laissés dehors, simplement parce qu’ils n’ont pas voulu venir quand Il les a suppliés de le faire ? Quelle terrible chose ce serait si le Sauveur était obligé de vous laisser dehors ; vous qu’Il a engagé si souvent à venir à Lui ; vous qu’Il a aimé au point de donner sa vie pour vous ; vous auquel Il dit encore en ce moment : « Détournez-vous, détournez-vous, pourquoi mourriez-vous ? » Pour Slaam Shaan il y avait encore l’espoir du lendemain ; mais quand la porte sera fermée devant vous, cela voudra dire que vous serez perdu, perdu pour toujours, et absolument sans espoir, — pour toujours loin de Dieu, dans les ténèbres du dehors ! Comment pouvez-vous attendre un jour de plus sans venir à Celui qui est votre rançon aussi bien que votre Rédempteur ?
Je suis heureux de pouvoir vous dire que le lendemain, de bonne heure, le messager arriva, et Slaam Shaan accompagnée d’un ami le suivit ; chacun d’eux portait un panier plein d’argent. Deux heures après le petit groupe revenait, Slaam Shaan et sa belle-fille pleurant de bonheur. Quelle joie que celle du Rédempteur et quelle joie que celle du racheté ! je me demande si mon lecteur a jamais éprouvé la plus merveilleuse de toutes les joies, celle de rendre heureux le coeur du Sauveur, du Rédempteur ?
« Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15:10).
Mes deux dernières histoires traitaient du Rédempteur et de la rançon qu’Il a payée pour vous racheter : aujourd’hui je voudrais vous parler d’un petit garçon qui fut presque perdu. S’il n’avait pas rencontré un Sauveur, il aurait péri et je n’aurais jamais eu le courage de vous raconter son histoire.
J’ai ici, en Chine, deux amis très spéciaux qui s’appellent Ah Gun et Ah Lin. Ah Gun est un beau petit garçon de quatre ans (j’ai le regret de devoir dire qu’il est un peu gâté !) et Ah Lin est sa soeur, âgée de six ans. J’allais dire sa grande soeur, mais je crois que Ah Gun est tout aussi grand, si ce n’est même plus grand qu’elle. Mais Ah Lin est une des plus charmantes fillettes que j’aie jamais vues. Je pense qu’elle est une vraie chrétienne, et c’est la meilleure petite mère que vous puissiez voir. Elle a un autre frère qui n’est qu’un tout petit bébé, et elle le porte partout avec elle, enveloppé dans un morceau d’étoffe rouge retenu aux quatre coins par de solides cordons qui passent sur ses épaules et sous ses bras. Elle doit être souvent très fatiguée de son fardeau, mais elle ne se plaint jamais.
Ah Lin et Ah Gun aiment beaucoup venir me voir. Ils n’habitent pas très loin de chez moi et Ah Lin tient soigneusement son petit frère par la main. Ils savent qu’ils trouveront, au terme de leur course, une tartine de confiture et peut-être une orange. C’est un régal qu’ils n’ont jamais chez eux où les repas se composent presque uniquement de riz — du riz pour le déjeuner, et du riz pour le souper (ils n’ont point de dîner), et peut-être parfois un peu de chou ou d’épinards, ou encore un petit poisson. Ils ne mangent pas comme vous le faites avec une cuiller, une fourchette et un couteau, mais ils se servent de deux longs bâtonnets qu’ils tiennent d’une seule main. Ils n’ont pas non plus d’assiette, mais seulement un petit bol, et ils mangent avec une dextérité telle que, si vous les voyiez, vous vous demanderiez comment ils peuvent y arriver.
Le père d’Ah Gun n’est pas riche, et votre père à vous se jugerait très pauvre s’il n’avait pour vivre que ce que gagne chaque mois M. Taam. Il est vrai que la petite famille doit se passer de bien des choses que vous et moi trouverions nécessaires, mais M. Taam est un homme heureux. Il y a quelques années il n’en était pas ainsi. Il travaillait dans une maison de jeu et menait une misérable vie, mais voici deux ou trois ans qu’il a reçu le Seigneur Jésus comme son Sauveur, et depuis lors toute sa peine s’est changée en joie. Il n’est pas besoin de dire qu’il ne travaille plus dans la maison de jeu ; mais il parcourt le pays comme colporteur, en vendant des évangiles, en distribuant des traités et en parlant aux gens du Seigneur Jésus qui l’a aimé et l’a lavé de ses péchés dans Son sang. Souvent il faut qu’il marche pendant bien des kilomètres portant une lourde charge de livres ; souvent il doit traverser des régions dangereuses, mais il est très courageux et ne recule devant aucune fatigue. Nous l’aimons beaucoup.
Mais je pense que vous désirez savoir ce qui est arrivé au petit Ah Gun. Eh bien ! un jour que son père était en route pour vendre ses livres, la mère fut obligée de sortir un moment et de laisser ses enfants seuls. Comme elle revenait à la maison, tout près de la porte de la ville, elle rencontra un soldat (quelques semaines auparavant il était un brigand, et je crains que son coeur n’ait pas été changé). Ce soldat n’était pas seul. Dans ses bras, il emportait Ah Gun ! Il se hâtait pour sortir de la ville le plus vite possible dans l’intention d’aller vendre l’enfant. Un beau petit garçon comme celui-là devait rapporter une grosse somme.
Vous pouvez vous représenter ce que ressentit la mère. Elle alla droit à l’homme, lui arracha son petit garçon et l’emporta à la maison. Combien Mme Taam dut être heureuse d’avoir passé en cet endroit précisément à cette minute, car un instant plus tard elle aurait manqué son enfant. Il était presque perdu, mais pas tout à fait. Il fut sauvé juste à temps.
Je n’aimerais pas être sauvé juste à temps, et vous ? Cela vaut mieux que d’être perdu, mais je craindrais en attendant si longtemps, de ne pas être sauvé du tout ; car vous savez que nous avons un ennemi, un plus grand ennemi que celui qui emportait Ah Gun, et qui essaie de voler les petits enfants ; il ne veut pas leur corps seulement, mais leur âme aussi, pour les entraîner pour toujours dans l’étang de feu. Oui, mes enfants, Dieu nous dit que Satan est meurtrier dès le commencement, et il désire votre vie. L’Écriture nous dit qu’il rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer, et il vous dévorerait volontiers. Mais, oh, quel bonheur ! il y a un Sauveur qui nous aime plus même que notre mère ne le fait, qui cherche à vous sauver, cher enfant, et qui désire le faire maintenant.
Ah Gun était presque perdu ; il fut sauvé seulement juste à temps.
J’espère que vous n’attendrez pas pour être sauvé « juste à temps », parce que je crains alors que vous n’arriviez trop tard et que vous ne soyez pas sauvé du tout. Oh ! chers enfants, venez maintenant, quand Jésus vous appelle. Il dit : « Voici, c’est maintenant le temps agréable ; voici c’est maintenant le jour du salut ». Ainsi vous n’avez pas besoin d’avoir peur, vous n’avez pas besoin d’attendre un instant de plus, mais venez maintenant au Seigneur Jésus et demandez-lui de vous sauver de votre ennemi, et je suis sûr qu’Il le fera. Mais souvenez-vous que Son moment est maintenant, juste maintenant ; pas demain, ni dimanche prochain, ni quand vous serez plus âgé, mais aujourd’hui, maintenant !
Vous savez sans doute que la Chine est un immense pays, et que sa population est très nombreuse. Les habitants ne vivent pas tous dans des maisons, mais beaucoup d’entre eux vivent sur l’eau. En Chine il y a un grand nombre de rivières, et, dans le voisinage des villes, ces cours d’eau sont encombrés par les bateaux. Près de Canton, par exemple, c’est à peine si on peut se frayer un passage entre les embarcations. Il y en a de toutes les grandeurs, mais les petites barques sont les plus nombreuses. On a peine à se figurer comment une famille entière peut arriver à se caser dans un espace aussi restreint. Souvent, sur un petit bateau qui n’est pas beaucoup plus grand que ne le serait un canot à rames chez nous, vivent un père et une mère, trois ou quatre enfants, sans parler des grands-parents.
Je dois dire que leur bagage est mince ; un ou deux « pais », ou édredons pour les garantir du froid, une natte qui sert de lit, deux ou trois escabeaux, un très petit fourneau de faïence et deux récipients où l’on cuit le riz et les légumes, voilà tout le mobilier de la famille, si vous y ajoutez quelques bols, les bâtonnets indispensables pour porter la nourriture à la bouche. Comme vêtements ils n’ont que ceux qu’ils portent sur leur dos. Mais il est un objet que je ne dois pas oublier de mentionner, c’est l’idole dans sa niche à l’arrière du bateau. Parfois cette idole est simplement taillée au couteau dans le premier morceau de bois venu, mais elle n’en occupe pas moins la place d’honneur ; matin et soir on brûle devant elle un bâton d’encens et on lui présente des offrandes de riz et de poisson.
La Parole de Dieu nous dit que les choses sacrifiées aux idoles sont en réalité sacrifiées aux démons (1 Cor. 10:20). Ces pauvres Chinois n’ont jamais entendu parler de Dieu, ni de son grand amour pour l’homme perdu, et ils vivent dans une terreur continuelle des mauvais esprits. Ils cherchent à détourner le sort funeste en offrant aux divinités malfaisantes de la nourriture ou d’autres dons. Ainsi toute cette population des rivières vit dans les ténèbres spirituelles les plus complètes. Des petits enfants naissent sur les bateaux, des vieillards y meurent, et il n’y a aucune connaissance de Dieu au milieu d’eux. Ils descendent très rarement à terre, et ils ne savent pas lire ; comment pourraient-ils apprendre ?
Eh bien ! il y a quelques missionnaires, mais ils sont bien peu nombreux, qui ont à coeur d’instruire ces pauvres gens. Ils vivent dans une barque un peu plus grande que celles qui les entourent et passent leur temps à aller d’un bateau, à l’autre dans un petit canot ou « sampan » afin d’apporter aux pauvres païens la bonne nouvelle de l’amour du Seigneur Jésus.
Il est très difficile d’atteindre le coeur de ces habitants des rivières. Ils sont si ignorants, si peu intelligents ! Il faut leur répéter bien souvent les récits de l’Évangile avant qu’ils puissent en comprendre quelque chose. Il est aussi excessivement difficile d’en rassembler quelques-uns pour écouter une prédication, et lorsque l’un d’entre eux semble commencer à saisir quelques bribes de la vérité de Dieu, voilà que son bateau part dans une autre direction et on ne le revoit jamais. Pourtant le bon Berger aime ces pauvres brebis errantes ; Il continue à les chercher et, de temps en temps, il y a de la joie dans le ciel pour un marinier qui se repent.
Il faut beaucoup de courage et de dévouement pour vivre au milieu d’une population aussi sale et aussi dépravée. Pour tenir bon, il est nécessaire que le coeur soit rempli par l’amour de Dieu et possédé par un grand désir de gagner les âmes pour Christ,
Supplions le Seigneur afin qu’Il bénisse ces courageux missionnaires et qu’Il leur donne de voir quelque fruit de leur travail.
J’en viens maintenant à l’histoire d’une petite fille qui naquit et passa toute sa vie sur un bateau semblable à ceux que je viens de vous décrire. Elle y vivait avec son père, sa mère, un frère et une petite soeur plus jeune qu’elle. Il est probable qu’un cochon et une demi-douzaine de poules complétaient la famille.
Lorsque Kum Taï était toute petite, elle passait la plus grande partie de son temps sur le dos de sa mère tandis que celle-ci faisait avancer le bateau au moyen d’une longue perche, car il transportait des passagers et des marchandises d’une rive à l’autre du fleuve. Quand l’enfant fut assez grande pour marcher seule, on fixa autour de son cou une sorte de bouée en bois, ou quelquefois on l’attachait par une corde au « pong » ou tente recouvrant le bateau.
Ce fut ainsi que Kum Taï atteignit sa quatrième année, tandis que sa petite soeur avait deux ans. Alors un grand changement survint dans la vie des fillettes. Leur mère avait assisté aux réunions tenues sur la barque des missionnaires ; elle fit profession d’être convertie et un jour elle vint demander aux dames qui s’étaient occupées d’elle si elles ne voulaient pas se charger de ses deux petites filles.
— Je ne gagne pas assez pour leur acheter du riz, assurait-elle.
Après mûres réflexions les missionnaires accédèrent au désir de la mère. Miss Trent prit la petite soeur sur son bateau et s’en alla à quarante kilomètres en amont. Miss Rowe garda l’aînée. Ce fut un heureux changement pour Kum Taï de vivre sur un grand bateau où elle avait une nourriture abondante, assez de place pour s’ébattre et des vêtements confortables.
Au début elle se montra très difficile à élever. Elle poussait des cris affreux quand on lui refusait quelque chose et, si quelqu’un la mécontentait, elle saisissait un bâton et manifestait sa colère par des coups. Mais peu à peu son caractère s’améliora. Miss Rowe lui parlait de Jésus et elle aimait par dessus tout les histoires de la Bible. Elle en réclamait sans cesse.
Si même un très petit enfant apprend à aimer le Seigneur Jésus, il essaie de Lui faire plaisir ; et bientôt Kum Taï devint si douce et si soumise que tout le monde s’attacha à elle.
Elle était pleine de vie et de gaîté et devint un vrai rayon de soleil pour Miss Rowe qui n’avait que des serviteurs chinois avec elle sur le bateau. Kum Taï aimait à chanter des cantiques. Son préféré ressemble à celui que vous connaissez sans doute. « Jésus m’aime, moi petit, oui Lui-même me l’apprit ». La mélodie chinoise est très jolie.
Deux années se passèrent ainsi, puis un jour la mère reparut et réclama ses fillettes. Vous ne devineriez pas pour quelle raison elle les redemandait. Elle voulait les vendre ! N’est-ce pas affreux ? Elle expliqua qu’elle avait besoin d’argent afin d’acheter une femme pour son fils, et qu’elle n’avait pas d’autre moyen de s’en procurer.
Les deux missionnaires furent très tristes. Elles firent tout leur possible pour détourner la femme de son mauvais dessein, mais elle tint bon et ne voulut pas entendre raison. Les deux dames étaient navrées à la pensée que leurs chères fillettes seraient vendues dans des maisons païennes où on leur enseignerait à adorer des idoles et à faire toutes sortes de choses mauvaises. Mais les missionnaires ne possédaient pas l’autorité nécessaire pour empêcher la mère d’agir comme bon lui semblait et elles durent lui rendre les enfants. Avec quelle tristesse elles les virent partir ! Les petites de leur côté s’en allaient gaiement, ne comprenant rien à ce qui se passait. Mais lorsque le soir arriva et qu’elles découvrirent qu’elles ne pouvaient plus retourner chez leurs amies, leurs pauvres petits coeurs semblèrent se briser. Elles pleurèrent et sanglotèrent et supplièrent jusqu’à ce qu’il ne leur restât plus de larmes. Enfin elles s’endormirent d’épuisement.
Le coeur de la mère fut ému et elle se dit : « Je rendrai la plus petite ». Lorsque l’enfant s’éveilla, elle la ramena au grand bateau, laissant Kum Taï endormie. Les missionnaires et la mère étaient encore en conversation lorsque tout à coup on entendit le bruit d’un corps tombant à l’eau et un grand cri. Pauvre petite Kum Taï ! Sans doute avait-elle voulu suivre sa mère, mais on ne sut jamais exactement ce qui s’était passé. Lorsqu’on eut réussi à repêcher le corps de l’enfant, elle avait cessé de vivre.
Nous disons : « Pauvre petite Kum Taï ! » Ne devrions-nous pas plutôt nous écrier : « Heureuse petite Kum Taï » ? Plus de demeure païenne pour elle maintenant, mais la maison du Père. Le bon Berger ne voulut pas permettre à son petit agneau de s’en aller dans ce milieu corrompu ; aussi la reprit-Il auprès de Lui à travers les grandes eaux.
Maintenant je désire demander aux enfants qui ont lu cette histoire vraie pourquoi nous pouvons penser que Kum Taï est auprès du Seigneur Jésus ? Serait-ce parce qu’elle était une bonne petite fille ? La Bible dit : « Il n’y a personne qui pratique le bien, non pas même un seul ». Pas même l’enfant sage qui lit cette histoire. Peut-être serait-ce parce que Kum Taï chantait des cantiques, et répétait des versets bibliques ? Non, car alors elle aurait été sauvée par ses oeuvres, et la Bible dit encore : « Non par des oeuvres, afin que personne ne se glorifie ». Il n’y a qu’un seul moyen de salut pour les grandes personnes ou pour les petits enfants, c’est le moyen de Dieu. Dieu nous aimait et Il voulait nous avoir auprès de Lui, mais nous ne pouvions pas entrer dans son ciel avec même un seul péché sur nous. Et ainsi, dans son grand amour, Il envoya Son Fils, le Seigneur Jésus Christ, dans ce monde, afin qu’Il portât nos péchés sur la croix. Notre petite Chinoise croyait ces choses, elle aimait Celui qui l’avait sauvée et, parce qu’elle l’aimait, elle désirait toujours entendre parler de Lui et voulait chanter des cantiques pour Le remercier. Elle cherchait aussi à Lui faire plaisir en se montrant douce et obéissante.
Maintenant Kum Taï attend auprès du Seigneur Jésus que nous nous retrouvions tous ensemble dans les places qu’Il a préparées pour nous. Serez-vous du nombre des heureux rachetés qui s’en iront à la rencontre du Seigneur en l’air ?
Quel beau nom pour un petit garçon ! Celui dont je vais vous raconter l’histoire était bien le plus précieux trésor de ses parents ; il était leur fils unique et les deux petites soeurs qui l’avaient précédé à la maison s’en étaient allées bien vite dans une demeure meilleure, auprès du Seigneur Jésus. Les parents ne se rendaient pas compte de la part bénie réservée à leurs petites filles, car au moment de la mort des enfants ils étaient encore païens et ne savaient rien du bon Berger qui prend ses agneaux dans ses bras et les porte sur son coeur. La mère, Mme Zing, était idolâtre et passait son temps en pèlerinages, allant d’un temple à l’autre avec des offrandes de cierges et d’encens. Elle espérait que la déesse de la miséricorde lui donnerait un petit garçon, mais, comme bien vous pensez, tous ses efforts n’aboutirent à aucun résultat.
Enfin un soir, comme elle revenait à la maison, bien lasse, ses petits pieds comprimés, écorchés par la longue marche, elle trouva son mari et un de ses amis qui s’entretenaient d’une nouvelle religion. Ils avaient assisté à un service tenu par un prédicateur chinois dans la ville voisine où ils étaient allés pour vendre des pommes de terre. Ce fut là le début d’une vie nouvelle pour cette famille. Le premier, M. Zing fut converti ; puis sa femme suivit et donna son coeur tout entier au Sauveur qui l’avait aimée et s’était livré lui-même pour elle. Une année plus tard Dieu leur envoya « Précieux Joyau », et quel trésor ne devint-il pas pour ses parents !
Après un certain temps M. Zing se voua à l’oeuvre du Seigneur. Il annonçait l’évangile dans les villages environnants et sa femme lui aidait en parlant à ses voisines. Vous pensez bien qu’elle ne négligea pas d’enseigner les choses de Dieu à son petit garçon et, tandis que « Précieux Joyau » écoutait l’histoire du Seigneur Jésus, il apprenait à aimer ce bon Sauveur et à mettre en Lui sa confiance. Tout jeune encore il remarquait combien sa demeure était différente de celles de leurs voisins. Pas d’idoles, pas de cierges, pas de bâton d’encens. Et l’enfant se mit à questionner son père et sa mère. En entendant leurs réponses, il se sentait de plus en plus reconnaissant envers Dieu pour la part qu’Il lui avait faite en lui donnant des parents chrétiens.
Le temps passa. « Précieux Joyau » fut envoyé à l’école de la Mission et, à l’âge de quatorze ans, il était bien connu parmi ses condisciples comme étant un disciple de Christ. Ses parents caressaient le secret espoir de voir leur fils devenir un serviteur actif à la suite du Maître, mais Dieu avait autre chose en réserve pour lui.
En 1900 éclata la terrible insurrection des Boxers pendant laquelle tant de missionnaires et de chrétiens chinois furent appelés à donner leur vie pour leur Seigneur et Sauveur. M. et Mme Zing et « Précieux Joyau » se rendaient compte du danger, mais ils refusèrent de chercher le salut dans la fuite. M. Zing ne pouvait se résoudre à abandonner les chrétiens indigènes qui avaient besoin de son aide et de ses conseils, et « Précieux Joyau » ne voulait pas quitter ses parents. Ils restèrent donc tous ensemble dans leur petite maison, se confiant en Dieu qui pouvait, soit les garder de tout mal, soit les retirer auprès de Lui s’Il le jugeait à propos.
C’était à la fin de juillet, un jour brûlant. Une troupe de Boxers entoura la paisible maisonnette et en força la porte. Quelles minutes plus tard, M. et Mme Zing étaient auprès du Seigneur. Mais les fanatiques se saisirent de « Précieux Joyau », lièrent ses mains et ses pieds, et le traînèrent dans la cour intérieure tandis que la chaumière était livrée aux flammes. Alors ils tracèrent une croix grossière sur la poussière, et ces hommes sans pitié entourèrent le petit prisonnier et lui ordonnèrent de cracher sur le signe sacré !
— Si tu refuses, dirent-ils, nous te tuerons. Tu dois encore nous promettre de persécuter les chrétiens, de renoncer à Jésus et de reconnaître que le culte des idoles est le seul qui convienne aux Chinois.
On lui accorda quelques minutes pour se décider.
Alors, calmement, car son Sauveur était tout près de lui, l’enfant répondit :
— Vous avez tué mes parents, vous avez détruit tout ce que je possédais au monde, et maintenant vous voudriez me faire renoncer à l’approbation de mon Père céleste. Mais je n’ose Le déshonorer. Quel que soit le sort que vous me réservez, vous ne pouvez que m’envoyer dans la présence du Sauveur que j’aime, là où mes bien-aimés parents m’ont devancé.
Encore quelques instants de souffrance, et l’âme rachetée de « Précieux Joyau » s’en était allée auprès du Seigneur. Plus de douleurs et plus de peines pour lui, mais la joie et le repos éternels dans la présence de son Sauveur bien-aimé. Vous voyez ce qu’il coûta à ce garçon de confesser Christ. L’avez-vous confessé vous-même ? S’Il vous a sauvé, vos parents, vos frères et vos soeurs savent-ils que vous Lui appartenez ? Souvenez-vous que la Bible dit : « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé » (Rom. 10:9). Ne vous tranquillisez pas en pensant : « Mon maître et mes camarades d’école du dimanche savent que je suis un chrétien ». Il faut que votre famille le sache aussi. Puissiez-vous dire en toute sincérité : « Je n’ai pas honte de l’évangile » (Rom. 1:16).
La ville de Yeong Kong, au sud de la Chine, se trouve dans une vallée entourée de trois côtés par de hautes collines. Dans cette vallée serpente un fleuve qui finit par se jeter dans l’océan lointain. De hautes murailles encerclent la ville. Quatre portes y donnent accès. Chaque soir, au coucher du soleil, elles sont fermées par des soldats. Plusieurs maisons cependant sont bâties en dehors des murailles, tout au bord de la rivière. Dans cette région de la Chine il pleut beaucoup, et quelquefois la rivière déborde, inondant les champs de riz et les habitations aussi.
Au mois de juillet 1922, mon mari et mes filles faisaient une tournée missionnaire. Ils voyageaient en bateau. Un matin leur vieux marinier leur montra un bel arc-en-ciel à l’horizon.
— Quand nous voyons un arc-en-ciel comme celui-là, nous savons qu’une inondation se prépare, dit-il.
Le vieil Ah Yik est un chrétien, mais il est très ignorant, et je pense qu’il ne sait rien de Noé ni de l’arc que Dieu a placé dans les nuées comme signe que la terre ne serait plus détruite par l’eau ; sinon il aurait été encouragé par la pensée que, même en jugement, Dieu se souvient de sa miséricorde.
Mais il ne se trompait pas quant à l’inondation. Cette même nuit s’éleva un terrible typhon ; la pluie tombait à torrents, le vent soufflait avec violence et le niveau de la rivière montait rapidement. Quand, deux jours après, mon mari retourna voir son bateau, il trouva la campagne entièrement couverte d’eau ; les vagues venaient battre la muraille de la ville. Les gens s’affairaient, les jambes dans l’eau, portant des paniers contenant des poulets, des chats, de jeunes chiens, et même de petits cochons qu’ils cherchaient à mettre en sûreté. On n’apercevait plus que le toit de certaines maisons, et quelques-unes, construites en boue, s’étaient complètement effondrées. Au milieu de la rivière se trouve une île assez vaste qui était entièrement sous l’eau, et les habitants avaient cherché un refuge sur le faîte de leurs toits. De petits bateaux flottaient là où deux jours auparavant on voyait de belles plantations de riz. Il ne se passa pas longtemps avant que mon mari et quelques chrétiens chinois se fussent procuré une embarcation pour porter de la nourriture à ces pauvres gens.
Ce fut en distribuant du riz sur cette île que nous découvrîmes la « Fidèle grand-mère », comme nous l’avons appelée dès lors. Elle était dans une triste situation. Elle était veuve ; son fils unique avait été noyé dans l’inondation et sa jeune femme tuée par l’effondrement de leur maison. Tout ce qui restait à la vieille femme était son petit-fils âgé de deux ans. Lorsque les eaux se furent retirées, ce qui arriva quelques jours plus tard, elle chercha à relever les murs écroulés de sa maison, mais elle dut en rester là faute de ressources. Cependant, grâce à l’aide de quelques amis, elle obtint la somme nécessaire pour faire poser un nouveau toit. Quelle triste demeure ! Tout ce qu’elle possédait avait disparu, et bien plus que cela, son fils unique et sa belle-fille étaient morts. C’était une femme courageuse ; elle se mit au travail pour essayer de gagner quelque chose en sarclant les champs de riz, et, dans l’eau jusqu’aux chevilles, son petit-fils attaché sur son dos, elle peinait tout le long du jour. Mais elle ne pouvait pas gagner beaucoup. Dix « cents » par jour est le salaire habituel que l’on reçoit pour cette besogne ingrate, et par le mauvais temps on ne peut travailler. Or dix cents (cinquante centimes) ne suffisent pas à entretenir deux personnes, et, très souvent, la seule nourriture des pauvres gens consistait en un peu de concombre ou de courge qui avait poussé dans le jardin. Le petit garçon tomba bientôt malade et sa grand-mère l’apporta à la Mission pour avoir des médicaments. Chaque fois qu’elle venait, on lui racontait quelque chose du Seigneur Jésus. Cela paraissait vraiment bien étrange à cette pauvre femme ignorante, élevée dans les ténèbres du paganisme, d’entendre parler d’un Dieu qui l’aimait — qui l’aimait assez pour avoir envoyé son Fils unique mourir pour elle. Quelle différence avec les « Gui » ou démons qu’elle était accoutumée à adorer, lesquels, pensait-elle, cherchaient constamment à lui nuire, et auxquels elle devait brûler de l’encens et offrir des présents pour détourner le mal qu’ils auraient voulu lui faire.
Elle ne reçut pas tout de suite la bonne nouvelle. Il lui fallut traverser encore bien des peines et des angoisses avant de se laisser trouver par le Bon Berger. Son petit-fils était sa grande consolation. Parfois, la nuit, il se réveillait et passait sa petite main sur la figure de sa grand-mère pour voir si ses yeux étaient humides de larmes, ce qui arrivait souvent, hélas ! Alors il se serrait contre elle et lui témoignait son affection par de tendres caresses ; mais s’il se trouvait qu’elle n’avait pas pleuré, il se retournait sur son lit et se rendormait.
C’était un enfant délicat que le froid et le manque de nourriture avaient fortement éprouvé, et au cours de l’été 1923 sa petite vie prit fin. Heureux enfant, retiré de ce triste monde pour être auprès du Seigneur qui a dit lui-même qu’Il était venu « pour sauver ce qui était perdu ». Mais quel chagrin pour la pauvre grand-mère ! Elle emprunta de l’argent et paya des prêtres pour brûler de l’encens, dire des prières et accomplir d’autres rites païens pour le petit esprit qui était maintenant auprès de Jésus ; mais elle était ignorante et désirait montrer ainsi l’affection qu’elle portait à son petit-fils. Et maintenant qu’elle était toute seule et désolée, elle parut plus disposée à écouter l’évangile. Peu à peu la bonne nouvelle pénétra tout doucement dans son coeur ; les ténèbres se dissipèrent lentement, les idoles furent abandonnées et la vieille femme suivit régulièrement les réunions. Enfin, un jour, elle confessa le Seigneur Jésus comme son Sauveur.
Au mois de mai 1924 elle fut baptisée, et je ne pus m’empêcher d’être frappée, en la rencontrant quelques jours après, de voir combien son visage avait changé depuis la première fois que je l’avais rencontrée. Son regard dur et désespéré avait fait place à une expression de douce paix.
Le Bon Berger, s’Il a perdu une brebis, va après elle « jusqu’à ce qu’Il l’ait trouvée ».
Wong était un petit Chinois qui, ayant suivi une école tenue par des missionnaires, apprit à croire au Seigneur Jésus et à l’aimer. C’était un élève attentif, et son coeur fut attiré de plus en plus vers le Sauveur qui cherche les petits enfants jaunes aussi bien que les blancs. À l’école il apprit aussi des cantiques, et dès lors partout où il allait, on pouvait l’entendre chanter les louanges de Dieu.
Un certain jour Wong et un de ses amis, converti comme lui, descendaient la rue en chantant de tout leur coeur. Leurs voix enfantines attirèrent l’attention d’un vieux savetier qui sortit sur le seuil de sa boutique pour mieux écouter.
La première fois que les deux garçons repassèrent par là, il les appela et les pria de chanter pour lui ; et, peu à peu, par ces cantiques, il fut amené à comprendre la vérité et à croire au Seigneur Jésus. Le résultat de ce changement dans le coeur du vieux savetier fut qu’il désira ardemment que d’autres aussi viennent à la connaissance du salut.
Un soir il invita quelques voisins à venir dans sa maison entendre chanter les garçons. Plusieurs acceptèrent, et l’intérêt éveillé fut si grand qu’ils revinrent bien des fois dans le même but. Au bout de quelque temps un missionnaire, ayant appris ce qui se passait, s’établit dans cette partie de la ville pour enseigner à ces gens quelque chose de plus du Seigneur et de son grand salut. Et c’est ainsi que des efforts de deux petits garçons résulta une oeuvre glorieuse pour le Seigneur.
Quelque temps après, Wong était dans un petit bateau qui descendait une rivière aux flots rapides. Près d’un endroit spécialement dangereux se dressait une idole de pierre. Quatre hommes qui se trouvaient dans la même embarcation se mirent à parler du secours que procurait cette idole dans les cas de naufrage.
— Oui, dit l’un d’eux en s’adressant à Wong, si quelqu’un court un danger quelconque sur cette rivière, il n’a qu’à regarder cette image et il ne sera pas noyé.
Wong savait très bien qu’il irriterait ces hommes, en les contredisant ; mais il ne pouvait pas laisser passer cette occasion de rendre témoignage à la vérité. Aussi dit-il courageusement :
— Cette image de pierre ne peut aider personne. Le Seigneur est le seul qui puisse sauver.
Cette parole souleva une véritable tempête parmi les hommes. Ils se mirent tous ensemble à tancer vivement l’enfant, cherchant à le convaincre qu’il avait tort et qu’eux-mêmes avaient raison.
Naturellement ce fut en vain. À la fin ils devinrent si furieux qu’ils décidèrent de forcer Wong à s’agenouiller devant l’image.
Wong déclara qu’il ne pouvait le faire, parce que la Bible lui avait enseigné qu’il ne faut adorer que Dieu seul.
Alors ils le saisirent par sa longue natte et frappèrent sa tête contre les bords du bateau jusqu’à ce que le sang jaillît de plusieurs blessures. Mais il ne céda pas.
— Vous pouvez me torturer et maîtriser mon corps, dit-il, mais mon âme restera libre.
N’était-ce pas une courageuse réponse de la part de ce petit Chinois ?
Alors ces méchants hommes s’écrièrent
— Si tu n’adores pas notre dieu, nous te noierons.
— Je ne l’adorerai pas, répondit Wong. Chaque fois que vous invoquerez votre dieu, j’invoquerai le Seigneur Jésus.
Alors ils le jetèrent dans la rivière. L’enfant disparut sous l’eau et ses persécuteurs se hâtèrent, à force de rames vers le rivage. Providentiellement quelques amis avaient assisté à la scène, mais de trop loin pour pouvoir intervenir efficacement. Ils guettèrent le moment où Wong reparut à la surface et réussirent à le saisir et à le ramener sur la terre ferme. Le jeune garçon avait perdu connaissance ; on l’étendit sur le rivage et ses sauveteurs firent tout leur possible pour le ramener à lui. À la fin il ouvrit les yeux, mais il ne savait pas où il était, ni qui se tenait près de lui. Il croyait être encore au pouvoir des méchants hommes, et murmura doucement :
— Vous dites « idole », mais je dis « Seigneur Jésus ».
Combien il fut heureux lorsqu’il commença à comprendre qu’il était au milieu d’amis qui connaissaient aussi le Seigneur Jésus et l’aimaient.
C’est tout ce que nous savons de Wong. Il ne mourut pas, mais se rétablit et resta fidèle à son Sauveur.
L’avenir est encore devant lui ; qui sait ? peut-être est-il appelé à porter l’Évangile à ses compatriotes. Que le Seigneur bénisse le brave petit Wong !
« Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10:32).
Un riche planteur de Virginie était couché, très malade, dans la ville de Richmond. Il était atteint d’une fièvre infectieuse et le docteur le jugeait mourant.
Il ne connaissait rien du salut par Jésus Christ, et avait vécu sans s’occuper ni de Dieu ni de sa propre âme. Quand le médecin lui apprit qu’il n’avait plus longtemps à vivre, il dit :
— C’est affreux de devoir penser à la mort quand on est encore si jeune et que la vie a tant d’attraits. Mais tout a toujours été contre moi.
À la fin son infirmière le quitta, craignant la contagion. Le docteur demanda alors au malade s’il consentirait à se laisser soigner par un jeune Chinois.
— Oh, cela m’est bien égal, répondit le planteur vous pouvez aussi bien me laisser mourir comme un chien. Quoiqu’il en soit, ce sera bientôt fini.
Dans un autre quartier de Richmond se trouvait une grande blanchisserie chinoise. L’un des jeunes garçons qui y travaillaient se nommait Ching. Il était natif de Chine, mais depuis qu’il était en Virginie avait appris à lire la Bible et à l’aimer, et était devenu un chrétien. L’amour de Dieu versé dans son coeur et l’espérance d’aller au ciel quand il mourrait, le rendaient très heureux ; et le grand désir de son coeur était de pouvoir faire quelques études, puis de retourner en Chine pour parler à ses compatriotes de Jésus et de son grand salut. Mais jusqu’à présent il n’avait vu aucun moyen de mettre son projet à exécution.
Le médecin connaissait Ching. Il alla le trouver à la blanchisserie et lui demanda s’il voulait aller soigner un malade, atteint d’une fièvre dangereuse.
— Il est riche et vous payera bien, ajouta-t-il.
Ching accepta cette proposition, car il était sûr que Dieu prendrait soin de lui. Alors le docteur l’emmena et le présenta à son client. Quelques jours plus tard, pendant que le malade sommeillait, Ching, assis dans le coin opposé de la chambre, lisait sa Bible. Tout à coup l’homme riche ouvrît les yeux et dît :
— Quel est ce livre stupide que vous lisez constamment ?
Cette parole peina beaucoup Ching, mais il répondit avec douceur :
— Ce n’est pas un stupide livre ; c’est le livre de Jésus, c’est mon passeport.
— Votre passeport ? Qu’entendez-vous par là ?
Pour toute réponse, Ching lut simplement ces deux versets :
« Il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés » que le nom de Jésus (Actes 4:12).
« Le sang de Jésus Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1: 7).
— Avez-vous bien dit « de tout péché », Ching ? Relisez-moi ces paroles encore une fois. Puis-je être purifié de mon péché ?
Ching relut le passage et ajouta :
— Oui, monsieur, vous pouvez être purifié de votre péché et le sang de Jésus Christ vous apportera la réalisation de ce que vous désirez.
Puis, à la demande du malade, Ching s’agenouilla près de son lit et demanda à Dieu de lui pardonner ses péchés, de lui donner un coeur nouveau et de faire de lui un de ses heureux enfants.
Il répéta cette prière chaque jour et au bout de quelque temps un grand changement se fit chez le malade. Il trouva le pardon, le salut et la paix en Jésus.
Puis son corps aussi bien que son âme reçut la guérison ; la fièvre tomba et bientôt il fut complètement rétabli. Quand il apprit le grand désir de Ching, il voulut se charger de son éducation et lui payer ses études.
Aujourd’hui cet homme est un heureux chrétien, et il emploie sa fortune à aider les ouvriers du Seigneur, tandis que Ching est missionnaire en Chine et travaille fidèlement à faire connaître Christ parmi ses compatriotes.
« Cherchez l’Éternel tandis qu’on le trouve ; invoquez-le pendant qu’il est proche » (És. 55:6).
« Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, car moi, je suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre » (És. 45:22).
J’ai été très intéressé en lisant l’histoire d’un jeune garçon chinois qui fut amené à confesser ouvertement le Seigneur Jésus comme son Sauveur à l’âge de treize ans.
Il avait quitté Wun-Chu où il habitait, dans la province de Chekiang, pour une ville située assez loin de là, afin de devenir le serviteur d’un prédicateur indigène. Il avait été soigneusement instruit dans la vérité par un missionnaire, M. Scott, qui est maintenant auprès du Seigneur.
Un jour le jeune garçon entra dans un temple bouddhiste et y trouva un vieillard adorant des idoles. Il attendit qu’il eût fini ses dévotions, puis, s’asseyant auprès de lui, lui demanda :
— Vénérable grand-père, les idoles vous voient-elles et vous entendent-elles lorsque vous les adorez ?
— Oui.
— Mais elles sont faites d’argile, vous le savez ; comment peuvent-elles répondre à vos prières ?
— Ce n’est pas l’argile que j’adore, mais au-dedans de l’idole il y a un esprit qui peut voir et entendre.
Le jeune garçon qui avait souvent entendu M. Scott répondre à de semblables raisonnements, reprit :
— Vous dites qu’il y a un esprit dans le dieu ; mais regardez celui-ci : il a la figure sale ; il y a très longtemps qu’il n’a pas été lavé. En voici un autre dont le nez est brisé ; et il n’a pas l’intelligence de le faire raccommoder. Celui-ci a eu une partie de la barbe arrachée, et il n’a pas été capable de se protéger. À quoi sert un esprit habitant un corps s’il ne peut pas en prendre soin mieux que cela ? Nous avons un esprit dans nos corps, et les rats ne viennent pas arracher notre barbe. Je puis vous parler et vous pouvez l’entendre à cause de cet esprit qui est au-dedans de nous. Si l’esprit quitte nos corps nous sommes morts comme les idoles et ne pouvons nous protéger nous-mêmes.
Le vieillard fut frappé de la sagesse de ces paroles et demanda au jeune garçon où il avait appris ces choses. Celui-ci répondit :
— À l’école de Wun-Chu. Mais je sais bien peu choses ; si vous allez chez le prédicateur, il vous en enseignera bien davantage.
Le vieillard suivit ce conseil et emmena sa femme avec lui. Ils entendirent parler du Sauveur et crurent en Lui. Ce fut le commencement d’une oeuvre véritable dans la ville où se trouvent maintenant une centaine de chrétiens.
Maintenant qu’en est-il de nos idoles ? Que voulait dire l’apôtre Jean, lorsqu’il terminait sa première épître par ces mots : « Enfants, gardez-vous des idoles » ? Notre devise ne devrait-elle pas être « Jésus seul » ? Ayant en Lui la vie éternelle, et étant un avec Lui quant à notre position devant Dieu, Il devrait assurément être l’objet de nos premières affections. N’oublions pas l’avertissement adressé par l’auteur inspiré à tous les chrétiens, jeunes et vieux : « N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde » (1 Jean 2:15-17).
Un chrétien chinois, prêchant l’Évangile à quelques-uns de ses compatriotes, et voulant illustrer par un exemple la manière dont il faut se confier dans le Seigneur Jésus, leur raconta la simple histoire suivante :
Un riche mandarin, vivant dans une contrée infestées par les brigands, craignait beaucoup qu’on ne lui volât un bijou précieux auquel il tenait infiniment. Personne n’ignorait qu’il était en possession de ce joyau, et la nuit il ne pouvait dormir par crainte de voir les brigands envahir sa maison. Il cacha d’abord son trésor dans le sol, mais il n’était pas tranquille. Ensuite, il le dissimula dans une fente de la muraille, mais cela ne le satisfit pas non plus. L’anxiété et le souci le faisaient dépérir et le rendaient tout triste.
— Pourquoi ne déposez-vous pas votre bijou dans le trésor impérial, où sont gardés les joyaux de l’empereur ? lui dit un jour un de ses amis. Ce fut une révélation pour le mandarin. S’il était un endroit où les joyaux de l’empereur étaient sûrement gardés nuit et jour, son trésor y serait en sécurité aussi. Il suivit le conseil de son ami, et son visage perdit aussitôt son expression soucieuse. Désormais, au lieu de craindre, il avait confiance. Les gardes vigilants qui veillaient sur les trésors de l’empereur défendraient aussi le sien.
— Il en est de même, ajouta le prédicateur, pour nous qui avons mis notre confiance en Christ. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, et seuls ceux qui seraient assez forts pour briser cette puissance divine pourraient jamais nous faire du mal.
Ce simple témoignage, rendu à la puissance protectrice de Dieu était vrai. Vous êtes-vous confiés en Lui, chers enfants, pour votre salut et pour votre vie de chaque jour ? Ne craignez pas de vous confier en Christ pour le temps et pour l’éternité.
Je suppose que tous les enfants qui liront ce livre ont vu un tigre, mais certainement la bête fauve se trouvait derrière des barreaux de fer, et elle était ainsi réduite à l’impuissance. En Chine, par contre, on rencontre beaucoup de tigres qui errent à leur gré dans les montagnes. Ces solitudes sauvages, avec leurs ravins et leurs cavernes, sont de vrais repaires de bêtes fauves.
Les collines qui entourent les villes sont, jusqu’à leur sommet, recouvertes de tombes. Le coeur se serre en voyant ces tertres innombrables et en pensant aux centaines de milliers de personnes dont les corps sont retournés à la poussière et qui jamais n’avaient entendu parler de Dieu ni de son grand salut. Une herbe longue et dure croit entre les tombes. Les femmes vont la couper et la vendent comme combustible, car en Chine le bois est rare et cher, et le peuple est très pauvre. Vous pouvez quelquefois rencontrer une demi-douzaine de femmes qui rentrent à la ville portant de lourdes bottes d’herbes sèches. Ces bottes sont attachées aux deux extrémités d’un bâton qu’elles portent sur l’épaule. Il semble, lorsqu’elles s’avancent ainsi, presque courbées en deux, que l’on se trouve en présence de petites meules de foin mises en mouvement par quelque mécanisme caché.
Or un jour, il y a quelques années de cela, une pauvre femme s’en alla sur les collines pour couper de l’herbe. Elle portait son bébé attaché sur son dos, et un autre enfant l’accompagnait. Elle tenait à la main une petite faucille. Au moment où la femme atteignait le sommet de la colline, elle entendit un rugissement effroyable. Épouvantée elle s’arrêta et attira son enfant tout près d’elle. Au même instant une tigresse, accompagnée de ses deux petits, bondit hors du fourré.
Sans doute la bête fauve croyait trouver une proie facile sur son chemin : une faible femme et deux petits enfants sans défense ! La tigresse prit son élan et vint s’abattre tout près de la pauvre mère. Celle-ci brandit sa petite faucille, la seule arme qu’elle eût entre les mains, et en frappa le monstre.
Il faut que je vous dise que, si cette femme chinoise était très courageuse, elle était aussi très ignorante ; elle n’avait de sa vie franchi le seuil d’une église, ni assisté à une réunion. Elle n’avait jamais vu de Bible, et, si même elle en avait possédé une, elle n’aurait pas été capable de la lire ; mais un jour, dans la rue de la ville qu’elle habitait, elle avait rencontré une missionnaire qui parlait à un groupe de femmes de Quelqu’un qui s’appelait Jésus. Elle leur disait que ce Jésus pouvait aider ceux qui étaient dans la peine et qu’Il était toujours là pour les secourir. Alors, au moment où le tigre broyait son épaule et son bras entre ses terribles mâchoires, la pauvre femme se souvint de ce récit merveilleux, et, tandis qu’elle frappait le fauve de son arme minuscule, elle criait :
— Ô Jésus, aide-moi !
Pensez-vous qu’Il entendit son cri ? Oui, assurément, car ses oreilles sont toujours ouvertes à nos supplications et Il nous a laissé cette promesse : « Invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai et tu me glorifieras ».
Nous faisons souvent des promesses que nous ne tenons pas. Peut-être les oublions-nous ; ou bien nous sommes incapables, au dernier moment, d’exécuter nos engagements. Mais avec le Seigneur Jésus il en va tout autrement. Il est dit d’Abraham en Romains 4 qu’il fut pleinement persuadé que ce que le Seigneur a promis, Il est puissant aussi pour l’accomplir. Nous pouvons avoir la même assurance. La pauvre femme fit une semblable expérience.
De sa main gauche elle continuait à frapper le tigre, et, chaque fois que la petite faucille s’abattait sur la tête monstrueuse, elle criait : « Ô Jésus, aide-moi ! »
La réponse ne se fit pas attendre. Au bout de quelques minutes la terrible bête, renonçant à maîtriser une proie qui pourtant ne lui offrait qu’une bien faible résistance, se détourna et s’enfuit dans la montagne. La pauvre femme, grièvement blessée, réussit à se traîner jusqu’au village ; elle perdait beaucoup de sang. Ses amis la transportèrent dans un hôpital missionnaire où on lui prodigua tous les soins que nécessitait son état et où elle se rétablit complètement.
Mais ce qui est encore mieux, c’est qu’elle apprit à connaître davantage ce Jésus qui l’avait sauvée de la mort ; et elle découvrit qu’Il pouvait aussi la sauver de la mort éternelle. David dit dans le Psaume 103: « C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités ».
Combien cette pauvre Chinoise dut être heureuse de trouver un tel Sauveur qui pouvait faire pour elle des choses si merveilleuses !
L’Évangile eut beaucoup de peine à pénétrer dans la province de Hunan, au centre de la Chine. Les gens y étaient endurcis et très conservateurs. Ils détestaient les étrangers et refusaient absolument d’écouter leur message.
Il y a bien des années, un missionnaire fut envoyé dans cette contrée. Personne ne voulait l’écouter et il se trouvait dans des circonstances très difficiles, car on cherchait même à le chasser de la ville.
Au moment où la situation paraissait la plus sombre, il arriva que la Société Biblique envoya à ce missionnaire une caisse contenant uniquement des exemplaires du livre de Jonas. Je ne sais pas combien il y en avait, peut-être quelques centaines. Ce livre fut lu. Il était trop intéressant pour être jeté au rebut, et bientôt un grand nombre des habitants de la ville connurent l’histoire du prophète désobéissant puis ramené à Dieu.
Non seulement ils lurent, mais ils crurent, et l’effet fut merveilleux. « L’homme qui est venu parmi nous est exactement comme Jonas », dirent-ils ; « il nous parle d’un jugement qui va venir, et nous ne voulons pas l’écouter. Si nous le chassons, peut-être périrons-nous tous, et peut-être sera-t-il puni lui aussi ».
Bientôt la ville fut ouverte au serviteur de Dieu, et il trouva autant d’auditeurs attentifs qu’il pouvait en désirer. Et de fait ce ne fut pas seulement une ville qui fut ouverte à l’Évangile par le moyen du livre de Jonas, mais tout le pays environnant, et la porte ne s’est jamais refermée depuis lors.
Quel livre merveilleux que notre Bible ! Toute la sagesse et la puissance des hommes ne pouvaient toucher un seul de ces coeurs endurcis, mais un seul coup de ce « marteau » qu’est la Parole de Dieu suffit pour ouvrir largement non seulement quelques coeurs, mais des villes et des contrées tout entières !
À des centaines de kilomètres de la ville ouverte à l’Évangile par le moyen du livre de Jonas, vit une vieille femme. Mme Koo, ainsi la nommerons-nous, était en service et passait la plus grande partie de son temps dans la cuisine la plus sombre et la plus enfumée que vous puissiez imaginer. Le plafond et les murs étaient depuis longtemps absolument noirs de suie. De grandes toiles d’araignées pendaient des poutres du toit ; et bien qu’elles fussent périodiquement enlevées au moyen d’un long balai, il s’en reformait bientôt de nouvelles. Le sol de la cuisine était fait de briques ainsi que le fourneau, et la partie supérieure de celui-ci était en tuiles rouges au milieu desquelles on avait ménagé un trou. Dans l’un des coins de la pièce, il y avait un tas de bois à brûler ; dans un autre, une sorte de bassin ou d’évier. Je ne sais pas si le fourneau avait une cheminée, mais la plus grande partie de la fumée semblait rentrer dans la cuisine ; ainsi en tout cas s’il y en avait une, elle ne servait pas à grand-chose.
Tel était l’endroit où s’écoulait l’heureuse et paisible vie de Mme Koo. Heureuse ? demanderez-vous. Oui, elle était très heureuse, et elle avait de bonnes raisons pour l’être. Elle connaissait le Sauveur et l’aimait. Il l’avait placée dans cette position, et c’était pour Lui qu’elle accomplissait son travail. Ce ne sont pas les cuisines aux carrelage étincelants, les fourneaux électriques et autres perfectionnements semblables qui rendent les gens heureux ; et Mme Koo, dans sa cuisine enfumée, était tout aussi satisfaite qu’une femme chrétienne de nos pays dans sa jolie cuisine claire — et beaucoup plus heureuse que les femmes qui ne sont pas des chrétiennes, quels que soient les autres avantages qu’elles puissent posséder.
Mais un jour la pauvre Mme Koo tomba malade. Sa jambe la fit beaucoup souffrir, et, les médecins chinois n’étant pas toujours très capables, cela alla de mal en pis jusqu’à ce qu’à la fin elle fut obligée de se faire transporter dans l’hôpital européen. Une autre femme prit sa place de cuisinière et Mme Koo se sentit très triste et quelquefois très isolée.
Quand enfin elle fut assez bien pour quitter l’hôpital, il sembla qu’on n’avait plus besoin d’elle dans la sombre cuisine, et elle en fut encore plus attristée. Mais quelqu’un lui dit :
— Mme Koo, maintenant que vous en avez le temps, pourquoi n’iriez-vous pas voir les voisines pour leur parler du Sauveur que vous connaissez ?
Mais Mme Koo répondit :
— Non.
Et aussitôt le diable trouva un soi-disant ami pour la décourager complètement.
— Une personne comme vous irait prêcher ? Une simple cuisinière ? Impossible.
Et Mme Koo répéta :
— Non, je ne puis prêcher. Je ne puis parler aux gens du Sauveur, et je ne le ferai pas.
Cette nuit-là, pendant qu’elle dormait, Mme Koo entendit une voix lui dire :
— Jonas !
Elle s’éveilla à l’instant, et « Jonas ! Jonas ! Jonas ! » continua à retentir à ses oreilles. Elle connaissait l’histoire du prophète qui avait été envoyé par Dieu prêcher aux Ninivites et qui refusa d’obéir. Elle savait tout cela et aussi ce qui arriva ensuite — et le reste de la nuit elle ne se sentit pas très à son aise.
Personne ne lui reparla de ce sujet, mais la première chose que fit Mme Koo le lendemain matin fut de dire très humblement : « Je suis prête à aller parler du Sauveur aux voisines ». Et elle s’en alla en effet visiter les femmes qu’elle connaissait dans leurs petites cuisines obscures et au milieu de leurs peines et de leurs soucis elle apportait souvent un rayon de lumière, la lumière d’en haut, pour éclairer leurs sombres vies.
Il y a quelques jours, j’ai appris que Mme Koo continue à visiter les voisines et que celles-ci aiment à la voir arriver en trottinant. Peut-être pourrez-vous prier le Seigneur de bénir Mme Koo et de lui donner la sagesse et l’amour dont elle a besoin pour parler à ces pauvres femmes ignorantes du Sauveur qui les aime. Je me demande si la même voix dira : « Jonas ! » à quelqu’un de mes lecteurs ?
Un colporteur rentrait un soir chez lui, dans la ville de Shanghai, lorsqu’il fut accosté par un jeune Turc d’apparence distinguée qui lui dit :
— Si vous le désirez, je vais lire votre avenir dans votre main.
Pris par surprise, notre ami ne répondit pas tout d’abord, et l’homme continua :
— Je suis un diseur de bonne aventure ; je puis vous dire ce qui vous arrivera dans l’avenir.
— Mais comment pourrai-je savoir que vous dites la vérité ?
— Oh ! j’ai des livres ; je connais l’astrologie.
— Bien, je voudrais d’abord vous poser une question, pour voir si vous dites vrai ou non. Si vous êtes capable de me dire la vérité quant à mon avenir, vous connaissez certainement aussi le vôtre. Où serez-vous dans cent ans ?
Le Turc parut très ennuyé et répliqua :
— Oh, je ne sais pas cela ; mais laissez-moi regarder votre main, et je vous parlerai de vous.
— Mais, reprit le colporteur, moi aussi je connais l’avenir. Je me sers aussi de livres, et si vous voulez répondre à une seule question, je vous dévoilerai votre avenir.
— Que voulez-vous savoir ?
— Croyez-vous au Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu ?
— Non, Il n’était pas le Fils de Dieu.
— Eh bien, reprit notre ami en sortant un Nouveau Testament de son sac, je vais vous dire votre avenir. Mon livre me dit : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui ». Voilà votre avenir : Maintenant, vous avez la colère du Dieu vivant reposant sur vous, et dans cent ans vous serez dans les ténèbres du dehors, loin de Dieu pour toujours, à moins que vous ne croyiez au Fils de Dieu.
Il s’ensuivit une longue conversation au bord de la route, et le diseur de bonne aventure demanda :
— Pourrais-je avoir un de vos livres ?
Cette requête lui fut naturellement volontiers accordée.
Il demanda ensuite
— Où habitez-vous ? Quand pourrais-je venir vous voir ?
Le jour suivant il vint avec un de ses amis à l’adresse indiquée, et ils eurent une longue conversation avec le colporteur, à l’issue de laquelle ils emportèrent un exemplaire de la Bible.
Dieu seul sait quel en aura été le résultat. Mais laissez-moi vous demander, cher lecteur, si vous avez jamais pensé à votre avenir éternel ? Vous n’avez pas besoin de rester dans le doute à ce sujet. Dieu soit béni, nous avons un Livre qui ne nous laisse jamais dans l’incertitude. Où serez-vous dans cent ans ? Où serez-vous demain ?
Peut-il y avoir quelque chose de plus simple, de plus catégorique, de plus précieux, et cependant de plus terrible que ces paroles solennelles : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3:36) ?
Une réunion devait se tenir dans la maison où les « diables étrangers » (autrement dit missionnaires) s’étaient installés dernièrement. Personne n’avait une idée très nette de ce qui se passerait dans cette réunion, mais Mme Lai et sa fille avaient invité leurs voisines à venir chez elles le dimanche après-midi à 3 heures. La plupart d’entre elles avaient décidé de venir — par curiosité naturellement. Ainsi elles se trouvaient là, assises sur les bancs du vestibule où régnait une délicieuse fraîcheur. Dehors, le soleil dardait sans pitié ses rayons éblouissants, mais ici une douce brise soufflait de la porte d’entrée à la cour intérieure.
Les femmes se tenaient très tranquilles, cherchant à saisir la signification de la nouvelle histoire que leur racontait Mlle Lai. Son chinois était encore très incorrect, et l’histoire était très différente de tout ce qu’elles avaient entendu jusqu’ici. Qui était ce Jésus ? Et comment, puisqu’il était mort depuis si longtemps, pouvait-il les aider maintenant ? Mais écoutez, à présent la dame parle plus simplement, nous pourrons toutes comprendre ceci.
— Vous savez, dit Mlle Lai pour illustrer ses paroles, comment on vend parfois une petite fille comme esclave. Quel est alors le chagrin de la mère ! combien elle soupire après le retour de sa fille ! Elle économise chaque sou dans l’espoir d’arriver une fois à racheter l’enfant. Peut-être un ami lui vient-il en aide. Enfin, quand la somme exigée est complète, avec quelle joie la mère se met-elle en route pour chercher sa fillette ! Celle-ci est libre désormais. Eh bien ! C’est ainsi que Dieu lui-même nous a rachetés du pouvoir du diable et du péché. Mais le prix de la rédemption n’a pas été de l’or ou de l’argent. Non, nos âmes sont trop précieuses pour être rachetées par de semblables choses. C’est le sang précieux de Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui nous a rachetés. Maintenant nous sommes libres de retourner à notre Père.
Puis on chanta un cantique, et, ce qui parut le plus incompréhensible de tout aux auditrices, une prière fut prononcée. Il y eut ensuite un moment de silence. Mlle Lai se demandait ce que les femmes avaient compris. Sans doute chacune interprétait à sa façon ce qu’elle avait entendu ; mais, pour l’une d’elles au moins, l’illustration donnée par Mlle Lai avait apporté un message distinct. En effet, deux de ses filles n’étaient-elles pas des esclaves ? Quelque chagrin qu’elle en eût éprouvé, il ne lui était jamais venu à la pensée qu’elles pussent être rachetées. Dès lors elle s’attacha à cette idée. Mais Mlle Lai avait aussi parlé d’aide, et dans l’esprit de Mme Wan, cette aide ne pouvait venir que des étrangers. La notion de Dieu, celle du péché et de la vie future étaient très vagues et n’avaient aucune réalité pour elle, mais elle sentait qu’elle avait besoin de quelque chose. Elle désirait du secours et un Sauveur à cause de sa pauvreté et de l’esclavage de ses filles, mais au lieu de se tourner vers Dieu, elle se tournait vers les étrangers. Et cependant, en y repensant plus tard, Mlle Lai comprit que c’était à partir de ce moment-là que le travail du Seigneur avait commencé dans cette âme.
Dès que la réunion fut terminée, Mme Wan s’approcha de Mlle Lai et se présenta comme une voisine habitant tout près, au coin de la rue. Puis, se hâtant d’en venir au sujet qui la préoccupait, elle ajouta :
— Oui, mademoiselle, et j’ai deux filles qui ont été vendues comme esclaves il y a plusieurs années. L’aînée est la troisième femme d’un homme riche, et elle est très malheureuse. La plus jeune n’a que douze ans, et je pourrais la racheter, si j’avais l’argent nécessaire pour cela.
L’expression pleine de sympathie de Mlle Lai encouragea la mère à émettre l’idée que la missionnaire pourrait jouer le rôle de l’amie qui aiderait à racheter l’enfant, comme elle l’avait expliqué pendant la réunion.
Un sentiment pénible d’impuissance envahit le coeur de Mlle Lai. Elle aurait volontiers mis la main à sa poche pour donner à Mme Wan la somme nécessaire au rachat de sa fille, mais malheureusement, oui peut-être heureusement, elle ne la possédait pas.
Mme Wan continua en disant que son mari était un chrétien.
— Vraiment ? dit Mlle Lai, surprise, a-t-il été baptisé ?
— Pas encore.
Mme Wan habitait au fond d’une petite cour très sale, une maison sombre et enfumée, avec un plancher de boue et pas de fenêtre. Un cochon, quelques poules et des oies s’y promenaient comme si l’endroit leur appartenait. Un petit garçon de huit ans, nommé Asei, ou Numéro 4, et qui aurait été joli s’il avait été un peu plus propre, suivait sa mère pas à pas, et elle tenait généralement dans ses bras un bébé d’un an, à l’air chétif. L’expression pensive de ce petit être montrait qu’il prenait la vie trop sérieusement. Ses yeux noirs semblaient considérer avec ressentiment la pauvreté et la saleté qui l’entouraient. Sa mère paraissait très insouciante et préférait sans doute le désoeuvrement au confort qu’elle aurait pu obtenir au prix d’un peu de travail.
M. Wan, petit homme maigre et vif, était cuisinier. Il travaillait pour une compagnie de soldats, qui ne lui donnaient qu’un salaire misérable, mais l’autorisaient à emporter tous les restes de leurs repas. Chaque soir il revenait à la maison chargé d’un grand panier de riz, de viande et de légumes, ce qui restait au fond de l’énorme chaudière de la caserne. Ces débris suffisaient généralement à nourrir la famille, y compris le cochon. Tant que les provisions arrivaient ainsi régulièrement, Mme Wan ne se mettait en souci de rien. À n’importe quelle heure du jour on pouvait la voir devant sa porte, bavardant en souriant, son bébé dans les bras.
M. Wan, par contre, était un homme sérieux. Il avait entendu parler du vrai Dieu et du Seigneur Jésus Christ par les catholiques romains, mais comprenait si peu de chose à la nouvelle religion qu’il n’avait pas encore renoncé à ses idoles. Mais maintenant, depuis que, soir après soir, il assistait aux réunions tenues dans la maison des Lai, assis sur le premier banc, les yeux fixés sur le prédicateur, il en saisissait davantage. À la fin une grande lumière se fit dans son esprit. Jésus, le Fils de Dieu, était mort pour lui, Il avait pardonné ses péchés. M. Wan était sauvé.
Un soir, comme la famille Lai venait de se mettre à table, un messager frappa à la porte.
— M. Lai voudrait-il venir pour aider M. Wan à se débarrasser de ses idoles ?
— Avec le plus grand plaisir, se hâta de répondre M. Lai. Il se rendit immédiatement au logis de M. Wan et bientôt les idoles furent réduites en pièces, sous les regards intéressés des voisins. M. Lai retourna chez lui, tout heureux.
— Maintenant, dit Mme Lai, il nous faut prier pour eux. Le diable s’acharne toujours sur les gens qui se tournent vers Dieu.
Peu de temps après M. Wan fut baptisé et, à sa demande et à celle de l’enfant lui-même, son petit garçon de huit ans fut baptisé avec lui. Mme Wan ne se sentait pas encore assez sûre d’elle-même pour suivre leur exemple. Elle assistait régulièrement aux réunions, son bébé dans les bras. Presque toutes les femmes faisaient de même, et quelquefois les enfants auraient considérablement troublé la réunion, si Mme Lai n’était pas venue à la rescousse avec un biscuit, rapidement glissé dans la main d’un petit pleurnicheur. Il est inutile de dire que, dans ces conditions, les bébés tenaient autant que leurs mères à assister aux réunions.
Mme Wan ne manquait pas une prédication, elle était une auditrice attentive, qui comprenait tout ce qui se disait. De fait elle savait parfaitement expliquer la doctrine aux autres femmes, lorsque celles-ci étaient embarrassées par le mauvais chinois de Mlle Lai. Mais Mme Wan ne pouvait pas être amenée à reconnaître qu’elle était une pécheresse, et cependant elle était souvent surprise en flagrant délit de mensonge. Quant à la paresse dans laquelle elle vivait, Mlle Lai doutait d’arriver jamais à lui faire comprendre que c’était mal.
Un jour Mlle Lai se rendit dans la misérable demeure pendant une des rares et courtes vacances accordées à la plus jeune des filles. Celle-ci était esclave depuis âge de huit ans, et avait été tellement maltraitée et obligée de travailler si durement, que maintenant, bien qu’elle eût treize ans, elle en paraissait à peine dix. Quelle pauvre petite créature cela faisait, avec ses vêtements grossiers beaucoup trop grands pour elle ! Sa chevelure formait une masse compacte pleine de vermine. L’enfant devait être au service de chacun, et personne ne se souciait d’elle. Mais quelle joie illuminait sa figure en ce moment ! Sa mère brossait sa tignasse embrouillée, lavait et raccommodait ses vêtements, pendant qu’elle avait le plaisir d’amuser son petit frère et de se sentir à la maison !
Et combien cela coûterait-il de la racheter ? Son maître en demandait cent quarante dollars.
Mme Wan espérait toujours que M. Lai donnerait la somme nécessaire, mais il estimait que ce n’était pas possible, puisque Mme Wan elle-même ne faisait aucun effort pour gagner quelque chose. Et cependant l’enfant avec son expression pathétique, était souvent, si ce n’est toujours, dans la pensée de la mère. Quelquefois elle rêvait d’élever des cochons et de les vendre au moment où le prix du porc serait élevé, avec un énorme profit ; mais les temps étaient durs et, quoique beaucoup de cochons aient passé par la maison des Wan, ils n’avaient jamais rapporté plus que le prix du loyer.
Alors la famille se trouva plongée dans une réelle détresse, car les soldats dont M. Wan était le cuisinier furent transférés dans une autre garnison, et il fut obligé de les suivre. Son salaire mensuel devint tout à fait insuffisant pour entretenir sa femme et ses enfants, du moment qu’ils n’auraient plus les restes de riz et de légumes dont ils s’étaient nourris jusqu’alors.
Mme Wan fut donc forcée de se mettre en quête d’un travail. Elle commença par fabriquer la monnaie de papier indispensable en Chine pour les funérailles.
Il ne faut pas un grand art pour cela, puisqu’il ne s’agit que de couper du papier à l’emporte-pièce. Malheureusement le gain est dérisoire et atteint rarement plus de 20 centimes par jour. Mais au bout de quelque temps, au grand soulagement de chacun, M. Wan revint à la maison.
Le bébé avait appris à marcher et à parler. Il avait de grands yeux noirs très vifs et savait se former une opinion personnelle sur n’importe quoi. Il aimait venir aux réunions qui se tenaient dans la maison des Lai, parce qu’à l’arrière-plan il y avait Mme Lai avec ses gâteaux. Il apprenait à chanter « Jésus m’aime » avec les autres enfants. Mais les services qui se tenaient dans le local officiel lui paraissaient très ennuyeux. Pas de gâteaux, et une sévérité, exagérée selon lui, au sujet de l’ordre et du silence ! Aussi un jour se laissa-t-il glisser des genoux de sa mère, et retourna-t-il tout seul à la maison le long des rues étroites. Cette aventure amusa beaucoup Mme Wan.
À la fin de l’été, le petit garçon fut pris d’une forte fièvre. On pensa qu’il ne s’agissait que de la malaria, et on lui donna de la quinine. Mais la fièvre ne voulait pas céder. Cependant, comme il n’avait pas d’autre symptôme alarmant, le médecin continua le même traitement. L’enfant devenait de plus en plus maigre, et l’inquiétude de sa mère augmentait.
Un jour Mlle Lai vint le voir. Le bébé était sur les genoux de sa mère, la tête appuyée contre son épaule, mais il sourit lorsque la visiteuse entra et retint un de ses doigts dans sa petite main pendant qu’elle s’entretenait avec Mme Wan.
— Mlle Lai me donnera un gâteau, murmura-t-il.
En les quittant, Mlle Lai fit une autre visite et, à son retour, vingt minutes plus tard à peine, elle jeta un coup d’oeil en passant dans la maison des Wan. Quelle douloureuse surprise quand Mme Wan l’accueillit par ces mots :
— Mon bébé se meurt !
En effet, les beaux yeux noirs se voilaient et les petits membres se raidissaient.
— Oh ! mon enfant, mon enfant ! gémissait la pauvre mère.
Les voisines accouraient.
— Ne le laissez pas mourir dans la maison ! dit la propriétaire d’un ton impérieux (Cela aurait attiré le malheur sur l’immeuble). La pauvre mère dut l’emporter dans la cour, et c’est là qu’il rendit le dernier soupir.
Quel désespoir pour la pauvre Mme Wan ! Pendant longtemps elle fut inconsolable, mais elle recherchait la présence de Mlle Lai qui avait assisté à la mort du petit. Celle-ci chercha à lui expliquer que son bébé était auprès du bon Berger qui « par son bras rassemble les agneaux et les porte dans son sein ». Elle la supplia de mettre toute sa confiance dans le Sauveur, de confesser ses péchés et de changer sa manière de vivre. Mme Wan paraissait d’accord, mais cet hiver-là ses voies furent plus tortueuses que jamais. Ses voisins païens eux-mêmes méprisaient sa façon d’agir.
Mlle Lai était tentée de l’abandonner à elle-même pour un temps, mais elle était obligée de passer devant sa porte deux fois par jour en se rendant à l’école, et Mme Wan se trouvait toujours sur le seuil, oisive comme de coutume et très disposé à bavarder.
— Entrez, dit-elle un jour d’un ton mystérieux. J’ai quelque chose à vous dire. J’ai eu une terrible frayeur la nuit dernière.
— Vraiment ? Que s’est-il passé ?
— J’étais assise ici sur ma chaise avant d’aller au lit, et la lampe était là, éclairant à peine, quand j’ai vu un grand diable noir s’avancer vers moi ; il a mis ses bras autour de moi et a cherché à m’entraîner. J’étais si effrayée que j’en avais des sueurs froides et que mes cheveux se hérissaient sur ma tête. J’ai appelé Asei, mais il m’a seulement répondu :
— Je n’ai pas peur, maman, et je ne vois point de diable.
Mais il a pourtant prié, puis il a chanté : « Seul le sang de Jésus », et pendant qu’il chantait, le diable est parti.
— Oui, dit Mlle Lai, parce que seul le sang de Jésus peut nous délivrer de la puissance des démons. Si vous ne vous repentez pas de vos mensonges et de vos tromperies, Satan s’emparera réellement de vous.
Mme Wan était trop impressionnée par son expérience de la nuit précédente pour se justifier comme elle le faisait d’habitude ; mais une voisine qui venait d’entrer et qui considérait évidemment toute l’affaire comme une bonne plaisanterie, s’empressa de prendre la parole :
— Moi, j’adore le diable, et ainsi il me fait toujours du bien, dit-elle
— Attendez la fin de votre vie, et alors vous verrez le résultat, répondit sèchement Mlle Lai.
De quelque façon qu’on puisse considérer cette apparition du diable, il est certain qu’elle produisit une grande impression sur Mme Wan, qui ne douta jamais de la réalité de ce qu’elle avait vu. Les Chinois n’ont pas besoin qu’on les convainque de l’existence du diable, car c’est une de leurs plus fermes croyances. Cette apparition, survenant ainsi lorsque Mme Wan se livrait à ses plus mauvais penchants, éveilla sa conscience. D’autres circonstances survinrent qui approfondirent le travail.
Un jour elle fut atteinte du choléra. Ses voisines vinrent la soigner, et une vieille femme lui brûla les mains et les pieds avec un fer chaud, traitement généralement adopté en pareil cas. Les violentes douleurs cessèrent, mais elle tomba dans une sorte de coma, et ses membres devinrent glacés. Pendant ce temps son pauvre mari qui lui était très attaché, pleurait et priait à côté d’elle.
Plus tard elle raconta ses impressions à Mlle Lai en ces termes :
— J’étais réellement en train de mourir, et mon âme était déjà à dix pieds de mon corps, mais lorsque j’ai entendu mon mari pleurer sur moi, je suis revenue.
Elle réalisait qu’elle avait été épargnée en réponse aux prières de son mari, et elle en éprouvait une impression très solennelle. Lui, de son côté, avait une foi très réelle, et, lorsqu’il était à la maison, il priait chaque jour avec sa famille. C’était pendant ses absences que Mme Wan se livrait à ses procédés malhonnêtes pour obtenir de l’argent sans travailler.
Mais bientôt survint une autre difficulté. Sa fille aînée qui était la troisième femme d’un riche marchand de la ville venait d’avoir un bébé. C’était une jolie femme de dix-huit ans et son mari lui témoignait de l’affection, ce qui excitait la haine jalouse de la première femme. Malheureusement le bébé était une petite fille. Tant que le mari fut là, la méchante femme n’osa pas toucher à l’enfant, mais il s’absenta au bout de quelques semaines, au moment où le coeur de la jeune mère s’attachait de plus en plus à sa fillette. Alors la cruelle femme lui enleva son bébé et le noya délibérément.
La pauvre jeune femme n’osa pas résister, mais resta comme atterrée par le chagrin. Lorsque Mme Wan apprit ce qui s’était passé, la douleur de sa fille et la pensée que sa situation était sans espoir parurent l’écraser aussi. Elle se mit alors à penser davantage à sa seconde fille. Celle-ci allait bientôt avoir seize ans, on la marierait, probablement dans les mêmes conditions que sa soeur, et un sort tout aussi cruel lui était sans doute réservé.
Mme Wan était désolée et, dans son désespoir, elle forma un projet qui lui parut admirable. Son principal talent était d’élever des cochons ; et elle décida de s’adonner à cette occupation avec plus de zèle que jamais. Sa propriétaire lui prêta une somme suffisante à l’achat de deux petits porcs. À ce moment M. Wan travaillait dans la ville et rapportait à la maison assez de résidus de toutes sortes pour nourrir ces animaux.
Au commencement les gorets prospérèrent admirablement. Les cochons boivent beaucoup et Mme Wan eut fort à faire pour leur puiser une quantité d’eau suffisante, mais elle ne se plaignait pas. Ils ont aussi besoin de verdure et Mme Wan allait patauger dans des étangs boueux pour leur procurer certaines feuilles vertes dont Ils étaient très friands. Bientôt elle put acheter un troisième porcelet. Les provisions de riz et légumes que M. Wan rapportait de la caserne suffisaient à peine pour une si nombreuse famille, mais si quelqu’un devait se priver de nourriture, ce n’était toujours pas les porcs. Mme Wan allait mendier à ses amis et voisins des débris de légumes et l’eau dans laquelle ils lavaient leur riz. Cela l’obligeait souvent à rapporter de lourdes charges, mais elle ne se plaignait pas. De fait elle était occupée toute la journée à puiser de l’eau, couper des légumes, et chercher de la nourriture pour ses cochons. Et précisément à ce moment elle entendit parler d’un bébé sans mère qu’elle se hâta d’adopter. Au milieu de tout son travail, elle lui accorda les plus tendres soins.
Les porcs faisaient certainement honneur à leur maîtresse. L’un d’eux en particulier devint si énorme qu’il excita l’envie de tous les voisins. « Quand le vendrez-vous ? » demandait-on constamment à Mme Wan. Mais elle répondait toujours qu’il n’était pas encore assez gros. Elle surveillait ses bêtes avec sollicitude et demanda même à Mlle Lai de prier pour elles.
Pendant ce temps le prix de la petite fille était monté à 160 dollars, mais elle travaillait tant qu’elle maigrissait, et son maître craignait qu’elle ne finît par mourir et lui fit perdre ses gains ; aussi envisageait-il plus volontiers la possibilité de se débarrasser d’elle.
La grande question était de savoir si les porcs rapporteraient assez pour racheter l’enfant. Mme Wan pensait qu’elle en tirerait une centaine de dollars, mais il en fallait 160. Elle regrettait d’être obligée de vendre les deux plus petits avant qu’ils aient atteint les gigantesques proportions de leur frère aîné. Mais sa fille s’excitait tant à l’idée d’être rachetée qu’elle en devenait presque malade.
La propriétaire vint à la rescousse en prêtant 50 dollars sur la sécurité du bébé — une sorte d’hypothèque. Les cochons furent vendus et rapportèrent plus même que n’avait espéré Mme Wan.
Enfin arriva l’heureux jour où M. Wan emporta 160 dollars en pièces d’argent chez le maître de sa fille. La rançon fut payée. Le coeur de l’enfant était plein à déborder tandis qu’elle suivait son père et franchissait avec lui le seuil de la maison où elle avait connu les horreurs de l’esclavage. Elle était libre ! Combien belle lui parut la modeste demeure qui serait son chez-elle désormais. Vous pouvez vous représenter ce que fut le revoir entre la mère et la fille, celle qui avait travaillé si longtemps et celle qui avait attendu patiemment la délivrance. Bien vite l’enfant sut prendre sa place de fille de la maison, et sa mère la suivait d’un regard ravi tandis qu’elle préparait le repas ou s’occupait du bébé !
Un grand changement s’était fait peu à peu en Mme Wan. Peut-être depuis le rachat de sa fille comprenait-elle mieux la grande rançon qui avait été payée pour sa propre âme. En tout cas il est certain qu’une transformation s’était opérée en elle. Elle était incapable d’expliquer ses sentiments, mais elle alla trouver Mlle Lai et lui dit très humblement et sérieusement qu’elle désirait être baptisée. Mlle Lai comprit alors que s’il y avait de la joie dans la petite maison à cause du rachat de l’enfant, il y en avait encore bien davantage devant les anges de Dieu pour la pécheresse qui s’était repentie ; et de son coeur reconnaissant montèrent des actions de grâces vers le Dieu qui fait des merveilles.
En parcourant nos pays civilisés en chemin de fer ou en automobile, on rencontre une quantité de fermes solitaires. Les unes sont grandes, les autres petites, mais elles sont séparées des demeures les plus proches par de vastes étendues de champs et de vergers. La plupart d’entre elles paraissent paisibles et confortables, entourées de leurs granges et de leurs étables ; en été les blés dorés ondulent sous la brise du soir, en automne les arbres des vergers plient sous le poids des fruits savoureux.
Je me demande si ceux qui vivent ainsi en paix et en sécurité ont jamais pensé à remercier Dieu pour cette grande bénédiction, et s’ils sont reconnaissants d’habiter dans un pays christianisé où les vies et les propriétés sont respectées, car dans les contrées païennes, où le seul vrai Dieu n’est pas connu, il en va tout autrement.
Lorsqu’un étranger voyage en bateau ou en chaise à porteurs à travers la Chine méridionale, la première chose qui le frappe, c’est le grand nombre de tours fortifiées qu’il rencontre ; une seconde cause d’étonnement est l’absence de maisons de ferme. Personne n’oserait vivre dans une habitation isolée ; les gens s’assemblent, bâtissent leurs demeures serrées les unes contre les autres et les entourent si possible d’une haute muraille, et, si cela ne peut se faire, ils plantent une épaisse haie d’épines tout autour du village. Quelquefois, au lieu d’une porte, ils mettent aussi un gros faisceau d’épines pour boucher l’ouverture qui sert d’entrée.
Et pourquoi toutes ces précautions ? À cause des brigands qui se cachent sur les collines et dans les lieux écartés et sortent la nuit en troupes nombreuses. Ils fondent comme des oiseaux de proie sur un petit village, s’emparent du bétail, des volailles ; ils dévalisent les pauvres gens, démolissent les maisons, tuent la plupart des habitants ou les emmènent prisonniers et ne les libèrent que contre rançon. Les paysans vivent dans une terreur continuelle, et voilà pourquoi ils bâtissent leurs demeures si près les unes des autres, et construisent les énormes tours que vous voyez dans toute la campagne chinoise.
Je me souviens d’avoir, il y a quelques années, remonté la rivière au bord de laquelle nous habitons jusqu’à une petite ville nommée « Puk Wan ». C’était un charmant endroit. Chaque maison avait son jardin planté de fleurs et de légumes. L’ami que nous allions voir, notre professeur de chinois, nous reçut très aimablement. Sa femme et sa fille apparurent bientôt, portant des bols de macaronis cuits dans de l’eau sucrée. Il fallut les manger avec des bâtonnets, ce qui est plus difficile à exécuter qu’à écrire. Lorsque nous eûmes fini notre repas, sous les yeux de toutes les femmes et de tous les enfants de la famille qui nous considéraient avec curiosité (mais on finit par s’y habituer), M. Faan nous emmena voir le village. La première chose qui frappa nos regards fut une tour élevée, aux épaisses murailles. On y pénétrait par une porte massive et ses fenêtres étaient très petites, de simples fentes, très haut, près du sommet. Il y avait plusieurs étages auxquels on accédait par un escalier tournant, et tout en haut une terrasse entourée d’un mur. Les hommes pouvaient s’y poster et jeter de là des pierres sur leurs ennemis, ou leur tirer dessus s’ils avaient des fusils.
— Mon père avait beaucoup d’argent, nous expliqua M. Faan, mais, au lieu de le donner à ses enfants, il en employa la plus grande partie à construire cette tour.
— Et vous en êtes-vous jamais servi ? lui avons-nous demandé.
— Pas jusqu’à maintenant, répondit-il, et nous sommes si pauvres que nous regrettons souvent l’argent que notre père a dépensé pour la bâtir.
Le jour suivant, avant de retourner chez nous, nous traversâmes la rivière pour voir la ville de l’autre côté. Elle se composait principalement d’une longue rue bordée de maisons, aux murs de boue sèche. Tous les cinq jours se tenait là un marché, où l’on pouvait acheter de la viande, du poisson, des légumes, du sucre de canne, du chanvre, du bois à brûler et bien d’autres choses encore. Les marchandises arrivaient en bateau, et la paisible rue se trouvait transformée en une scène de bruit et de confusion. Ces marchés qui se tiennent dans toutes les grandes villes offrent une bonne occasion d’annoncer l’Évangile et de distribuer des traités aux paysans venus des villages isolés où nul missionnaire n’a pénétré. C’est une grande joie de voir une Chinoise à l’expression heureuse, assise sous un arbre, son panier plein d’Évangiles et de traités ; les femmes et les enfants s’assemblent autour d’elle et l’écoutent chanter un cantique ou réciter un verset de l’Écriture, puis raconter très simplement l’antique histoire. Ou parfois un missionnaire étranger est parvenu jusqu’à cette ville et, dans son meilleur chinois, il parle à la foule du seul vrai Dieu et de Jésus Christ qu’Il a envoyé. Plus d’un coeur plongé dans les ténèbres a reçu son premier rayon de lumière dans un marché.
Environ un an après notre visite, M. Faan était chez nous lorsqu’il reçut la nouvelle que les brigands étaient venus à Puk Wan. Ils s’étaient emparés du village et des boutiques, mais les habitants s’étaient tous réfugiés dans la tour, et jusqu’à ce moment aucun n’avait été pris. Que fallait-il faire ? La femme, la fille et les trois petits garçons de M. Faan étaient tous enfermés dans la tour.
— Il faut que j’y aille tout de suite, dit le pauvre homme, et vous prierez pour nous.
Nous le lui promîmes, et le lendemain matin il se mit en route. M. Faan était un homme grand et maigre, et d’un caractère très timide. Se confiant en Dieu pour être gardé, il fit cette longue course de quinze kilomètres, arriva sans encombre et put pénétrer dans la tour sans avoir été vu par les brigands.
Quelle confusion régnait à l’intérieur ! Environ quatre cents personnes y étaient rassemblées, il n’y avait pas assez de place pour qu’elles pussent toutes se coucher, la nourriture était très peu abondante, et l’eau potable était rare. Un brave homme se glissait dehors chaque soir et rapportait deux grands seaux qu’il avait remplis à la fontaine ; mais c’était courir un gros risque, car les brigands possédaient des fusils et ils étaient constamment sur le qui vive.
Je suis sûr que Mme Faan et ses enfants furent bien contents de revoir leur protecteur, et quelle fut la première chose qu’il dit ?
— Il nous faut prier.
Les autres gens se moquèrent de lui. Ils étaient tous des païens et ne savaient pas ce que le Dieu des chrétiens peut faire. Pendant quatre ou cinq jours les brigands restèrent là. Ils se nourrissaient des volailles trouvées dans le village, ils s’emparèrent des couvertures, des vêtements et d’autres biens des voisins, mais ils ne prirent pas une seule chose dans la maison de M. Faan.
Pendant tout ce temps il priait et les gens se moquaient de lui, mais le cinquième jour, sans raison apparente, les brigands quittèrent la ville en sonnant de la trompette et en battant du tambour. Combien les habitants furent heureux de rentrer dans leurs demeures ! Beaucoup de choses avaient été emportées, mais les maisons étaient encore debout et personne n’avait été tué. Comprirent-ils que c’était Dieu qui les avait protégés ? Je ne puis le dire, mais M. Faan au moins savait ce qui en était, et que d’actions de grâces nous rendîmes ensemble à Dieu, lorsqu’il fut de retour auprès de nous et nous eut tout raconté.
Peu de temps après, notre professeur loua une maison dans notre ville et y amena sa femme et ses enfants. Plus tard je retournai encore une fois à Puk Wan ; quelle différence d’avec ma première visite ! Les brigands y étaient revenus et tout avait été pillé. Ces méchants hommes avaient employé le bois des fenêtres et des portes pour faire des feux au milieu des maisons. Plusieurs toits s’étaient écroulés, des murs avaient été renversés, et personne n’était resté dans cette scène de désolation. Le marché avec sa bruyante animation n’était plus qu’une chose du passé et l’herbe poussait maintenant librement là où s’élevaient autrefois les échoppes aux vives couleurs. Je me détournai tristement de cette scène de ruine, sentant combien sont misérables ceux qui essayent de vivre sans Dieu.
Et maintenant voulez-vous chercher avec moi un passage dans le chap. 18 des Proverbes. Nous lisons au verset 10: « Le nom de l’ÉTERNEL est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve en une haute retraite ». Vous êtes-vous réfugié dans cette tour, cher enfant ? Peut-être direz-vous : « Ce n’est pas pour moi, je ne suis pas juste ». Comment Abraham est-il devenu juste ? Lisez Genèse 15:6: « Et il crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice ». C’est le fait même que vous êtes venu à la Forte Tour qui prouve que vous avez la justice d’Abraham. Et qu’est-ce qui vous attire vers la Tour ? Qu’est-ce qui poussait les pauvres habitants de Puk Wan à courir si vite vers le refuge qui leur avait été préparé ? C’était un sentiment de besoin, un besoin désespéré ; ils croyaient que dans la tour se trouvait le salut et ils y couraient. Avez-vous jamais senti votre besoin ? Avez-vous jamais pensé qu’un jour vous devrez mourir, et « qu’après la mort vient le jugement » ? Ne faites pas comme un petit garçon juif à qui on avait parlé du salut en Jésus : il écouta attentivement et dit : « Ce sera une bonne chose à se rappeler quand le jugement viendra ». Oh ! ce sera trop tard. C’est maintenant que vous avez besoin d’entrer dans la Forte Tour. « L’homme avisé voit le mal et se cache ; mais les simples passent outre et en portent la peine » (Prov. 22:3).
Je faisais une longue course à pied en compagnie d’un ami chinois, et nous suivions un sentier serpentant à travers d’interminables champs de riz lorsque, pour tromper la longueur du chemin, j’eus l’idée de demander :
M. Taam, avez-vous jamais eu quelque aventure avec des brigands ?
— J’ai eu à faire avec les brigands en plusieurs occasions, répondit-il d’un air pensif. Il y a une dizaine d’années, lorsque je n’étais pas encore chrétien, j’habitais loin d’ici, tout au haut de la vallée, là où les montagnes sont resserrées et où les brigands trouvent de nombreuses cachettes. L’hiver avait été particulièrement propice aux bandits, et à ce moment-là, ils détenaient vingt-neuf personnes du voisinage enfermées dans leur forteresse qui était une caverne située au fond d’un étroit défilé. Parmi ces vingt-neuf personnes se trouvait la jeune femme d’un de mes meilleurs amis. Vous pouvez vous imaginer combien ardemment il désirait la délivrer. Les parents des autres prisonniers avaient aussi rassemblé de l’argent pour les racheter. Il fallait une centaine de dollars pour chacun, trois mille dollars en tout pour payer leur rançon. La somme était prête. La difficulté était que personne ne voulait se risquer à l’apporter aux brigands, parce qu’ils avaient une telle réputation de cruauté et de fausseté qu’on supposait qu’ils s’empareraient de l’argent et tueraient le messager.
Alors, continua Taam Sin Shaang comme s’il cherchait à s’excuser, je pensai que la vie d’un homme ne peut se comparer avec celle de vingt-neuf personnes, et je me dis aussi qu’il devait être bien pénible pour cette jeune femme de se trouver dans ce repaire de brigands, ainsi je me proposai pour apporter la somme voulue.
Un ami se joignit à moi et nous emportâmes les deux paniers pleins d’argent à travers l’étroit défilé jusqu’à la caverne. Les brigands sortirent à notre rencontre et il se trouva que notre arrivée était des plus opportune. En effet le chef, qui se comporta à notre égard avec politesse, nous dit en acceptant notre offrande :
— Il est heureux que vous n’ayez pas tardé davantage à venir, car j’avais ordonné à mes hommes de prendre tous les prisonniers et de les fusiller à l’aube. Maintenant ils peuvent s’en aller libres.
Ils repartirent donc tous avec nous et furent bientôt en sûreté dans leurs maisons.
Combien souvent cette histoire m’est revenue à la mémoire en pensant à Celui qui est le Seigneur du ciel et qui n’a pas seulement risqué sa vie, mais qui l’a donnée pour me racheter. Car j’étais un prisonnier, sous la haïssable domination du péché ; et plus que cela, j’étais sous une sentence de mort, car il est écrit : « L’âme qui a péché, celle-là mourra » (Ézéchiel 18:20). Mais Jésus a subi sur la croix le châtiment que j’avais mérité. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois.
« L’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de nous tous » (Ésaïe 53:6). Quelles heures sombres Il dut traverser ! Quand Il fut cloué sur la croix entre deux malfaiteurs, et qu’Il portait sur Lui le fardeau de nos péchés, Il s’écria : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
C’est la valeur de ce sacrifice qui nous délivre.
« Vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ » (1 Pierre 1:18, 19).
La petite ville de Hop Shaan au sud de la Chine a souvent eu à souffrir de la part des brigands. Il faut dire que sa situation est spéciale. Elle se trouve dans une vallée au milieu d’une région montagneuse remplie de cavernes, de profonds ravins, de forêts, de villages à demi abandonnés et de vieilles tours qui offrent une quantité de refuges et de cachettes aux bandits.
En 1920 Hop Shaan était dans une situation désespérée. Les brigands attaquaient successivement chaque village et, après s’être emparés de tout ce qui avait quelque valeur, ils emmenaient comme otages hommes, femmes et enfants, et leurs parents étaient obligés d’hypothéquer leurs champs pour pouvoir payer la rançon demandée. Si on ne trouvait pas la somme requise, les brigands tuaient souvent leurs victimes. Finalement la campagne avait été presque complètement abandonnée, sauf par ceux qui étaient trop pauvres pour avoir encore quelque chose à perdre, tandis que les tours massives de Hop Shaan étaient pleines de réfugiés. Les soldats envoyés contre les brigands n’étaient pas de force à lutter avec eux dans cette contrée montagneuse que les bandits connaissaient si bien.
À la fin, quand chacun était désespéré, un marchand de Yeong Kong, la capitale du district, suggéra au gouverneur un plan qui, espérait-il, devait rendre la paix à Hop Shaan. Ce plan était très simple ; il consistait à demander aux brigands de traiter avec eux. Cette « invitation à la paix » est un expédient bien connu en Chine pour se débarrasser des bandits, mais il est très difficile à mener à bien, parce qu’il dépend d’un intermédiaire dans lequel il faut à la fois que le gouverneur et les brigands aient une confiance implicite.
Leang Choi Fung s’offrit alors comme médiateur. Il était originaire de Hop Shaan où il avait plusieurs parents et amis, mais depuis bien des années il tenait un commerce de fers à Yeong Kong où sa figure ronde et joviale était bien connue. Il avait été converti au christianisme dès son jeune âge, et aucune ombre de soupçon ou de déshonneur n’avait jamais entaché son nom. Le gouverneur de Yeong Kong avait pleine confiance en lui et lui donna toute autorité pour traiter avec les brigands. Mais ceux-ci se fieraient-ils assez à lui pour accepter ses conditions ? Il s’en alla à Hop Shaan, et se mit bientôt en communication avec les voleurs. Voudraient-ils se rencontrer avec lui pour discuter les conditions de paix ?
Oui, ils décidèrent d’accepter. Ainsi donc Leang Choi Fung eut une entrevue avec le chef, dans laquelle il fit sa proposition. S’ils voulaient rendre leurs armes et entrer dans l’armée comme soldats de la République, leurs crimes passés seraient pardonnés et oubliés, et, au lieu de demeurer hors la loi et sous une sentence de mort, ils seraient de nouveau considérés comme citoyens chinois. Comme garantie, il donnait sa parole à laquelle il n’avait jamais manqué.
L’offre paraissait très généreuse, et Leang Choi Fung savait en présenter tous les avantages.
Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous, heureux si Dieu, de sa propre grâce, vous offrait la paix et la réconciliation ? Écoutez ceci :
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous supplions pour Christ : Soyez réconciliés avec Dieu » (2 Cor. 5:19, 20).
Après avoir écouté la proposition de Leang Choi Fung, les brigands se retirèrent pour discuter. Il y avait quelque danger, parce qu’il était arrivé parfois qu’un gouverneur peu scrupuleux avait « invité les brigands à la paix », et aussitôt qu’ils avaient été en son pouvoir il les avait tous tués. Mais la troupe de Hop Shaan décida que le nom et la réputation de Leang étaient tels qu’on pouvait avoir confiance en lui. La vie aventureuse en marge de la loi a bien son charme, mais qu’est-ce que cela comparé au bonheur de mener une existence paisible avec femme et enfants ? Le résultat de la discussion fut que toute la bande décida d’accepter la proposition de Leang. Au jour fixé, les brigands se présentèrent tous, rendirent leurs armes, et entrèrent dans l’armée chinoise comme soldats de la République.
La joie que cette nouvelle souleva dans la contrée peut à peine être imaginée. Riches et pauvres étaient également reconnaissants d’être délivrés de l’esclavage et de la terreur que les bandits répandaient autour d’eux. Tous s’unirent pour remercier Leang Choi Fung de la paix qu’il avait apportée au pays.
Leang Choi Fung lui-même était le plus heureux de tous. Il éprouvait les sentiments d’un père à l’égard des malfaiteurs qu’il avait sauvés, et fit de grands efforts pour les aider dans leur nouvelle vie. Il essaya de leur assurer une concession de terrain en sorte que chacun des brigands repentants pût posséder un petit domaine. La Chine n’est pas un pays où les beaux espoirs se réalisent toujours, mais, même si tout ne s’arrangea pas dès lors absolument comme on aurait pu le désirer, « l’invitation à la paix » eut pourtant de magnifiques résultats.
Mais avant tout, elle nous donne une belle image de ce que Dieu nous offre. Car de coeur nous sommes, ou nous étions, tous des rebelles contre Dieu, n’étant pas soumis à la loi de Dieu et ne le pouvant même pas. Mais Dieu, dans sa grâce, au lieu de nous détruire, nous offre la paix. Cette paix nous est garantie sur la parole du grand Médiateur entre Dieu et les hommes, l’Homme Christ Jésus.
De même que les brigands acceptèrent la proposition de Leang Choi Fung parce qu’ils avaient confiance en sa parole, de même puissiez-vous accepter l’offre de Christ quand Il vous demande d’être réconciliés avec Dieu.
C’était un joli petit lit de fer, verni en blanc, comme celui dans lequel vous dormez chaque nuit, mes enfants ; seulement il avait dans le haut une monture de métal pour soutenir un moustiquaire, car il devait être utilisé dans le sud de la Chine où il y a beaucoup de moustiques ; et ceux-ci ne sont pas seulement redoutés à cause des terribles démangeaisons produites par leurs piqûres, mais aussi parce qu’ils transportent la malaria.
Le matelas était tout neuf aussi. Il n’était pas tout à fait comme les vôtres, car, au lieu de contenir de la laine et du crin, il était fait de copeaux de bambou, cette plante étant très abondante dans le sud de la Chine.
J’avais acheté le lit et son matelas dans un grand magasin de Hong Kong, et je l’avais fait emballer soigneusement dans des nattes de bambou et du papier huilé, parce qu’il devait faire un long voyage.
Il n’y avait pas d’agences d’expédition, et je ne pouvais pas non plus charger le magasin d’envoyer le lit pour moi. Non, et c’était une affaire bien plus compliquée d’emporter mon acquisition chez moi, à 300 kilomètres de là, que de l’acheter. Mais pour commencer tout parut s’arranger facilement.
C’était un vendredi que j’avais fait mon achat et je découvris tout à coup qu’une petite jonque devait partir pour la ville que nous habitions, le lundi suivant. Tout heureux, je payai le prix du transport et la somme demandée pour porter mon lit du magasin sur le bateau.
Puis je dus le laisser, car le vieux missionnaire à l’intention duquel je l’avais acheté était malade et avait besoin de moi, et j’espérais pouvoir le rejoindre par un moyen plus rapide que la jonque.
Je ne veux pas vous raconter tous les incidents de mon retour, mais me contenterai de vous dire qu’après une semaine de voyage ininterrompu j’arrivai à la maison. Une des premières questions que l’on me posa fut :
— Où est le nouveau lit ?
Je racontai gaiement la bonne chance que j’avais eue de trouver la jonque sur le point de partir ; et quoique nous sussions bien qu’elle pouvait mettre trois semaines à arriver si les vents étaient contraires, nous étions tout disposés à l’attendre patiemment, puisque nous avions l’espoir que le pauvre malade pourrait bientôt échanger sa couche actuelle, formée de trois planches posées sur des chevalets et recouvertes seulement d’une couverture, contre un vrai lit à ressorts avec un matelas.
Les semaines s’écoulaient, mais le lit n’arrivait pas. Que s’était-il passé ? La jonque avait-elle fait naufrage ? Ou bien (et c’est là ce que nous jugions le plus probable) les pirates s’étaient-ils emparés de la barque et de sa cargaison ?
Hélas, nos pires craintes se trouvèrent bientôt réalisées, car au bout de six semaines d’attente, l’un des marchands arriva, apportant la triste nouvelle que tout avait été capturé.
— Que payeriez-vous pour racheter votre lit ? nous demanda-t-il, voulez-vous donner 60 %, de sa valeur ?
— Nous ne faisons pas de commerce avec des voleurs, fut notre seule réponse. D’autres messagers vinrent ensuite :
— Voulez-vous payer 30 % ?
— Non, nous ne traitons pas avec des voleurs.
— Combien payeriez-vous ?
— Pas un centime.
C’était pénible, mais nous ne voulûmes pas céder, et les négociations tombèrent. Nous prîmes le parti d’en rire, et nous plaisantions quelquefois avec le vieux missionnaire (qui entre temps s’était rétabli sur sa couche primitive) en pensant au chef des pirates, sans doute confortablement étendu sur le joli lit blanc et jouissant du matelas moelleux, luxe inconnu de lui jusqu’alors.
Cela faisait partie de ces « toutes choses » dont il faut être prêt à accepter la perte, comme l’apôtre Paul autrefois, et qu’il faut savoir « estimer comme des ordures », pour l’amour de Christ ; aussi cette perte ne nous laissa-t-elle aucune pensée d’amertume, quoique nous présentâmes l’affaire au Seigneur.
Mais la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Un jour un de nos amis apparut tout excité. Le lit arrivait ! Ou plutôt la jonque arrivait ! Les soldats avaient arrêté les pirates. Peut-être le chef sommeillait-il dans le nouveau lit : on ne nous donna pas de détails, mais chacun était très excité.
Quelques jours se passèrent, et alors enfin arriva l’objet du litige. Nous sortîmes à la rencontre des porteurs, assez anxieux de voir dans quel état le chef des pirates avait laissé le lit. Mais il n’avait pas même été déballé. Peut-être ne se doutait-il pas de ce que c’était, mais en tout cas il ne sut jamais de quel confort il s’était privé !
Un monsieur chinois accompagnait le colis et nous lui demandâmes le montant des dépenses que nous pensions devoir être très élevé ; mais à notre grand étonnement il n’y avait rien à débourser. La taxe, le transport, les soldats, les porteurs, tout était payé. Il nous dit :
— La jonque et toute la cargaison sont revenus à cause de votre lit. Ce doit être votre Dieu qui en a pris soin, ou autrement nous n’aurions jamais revu nos effets.
En vérité ce n’est jamais en vain qu’on se confie en Dieu, et vous, mes chers enfants, vous avez chacun une âme plus précieuse que tous les biens de ce monde. Pouvez-vous dire avec l’apôtre Paul : « Je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu’à ce jour-là » ? (2 Tim. 1:12).
« Bienheureux tous ceux qui se confient en lui ! » (Ps. 2:12).
« Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en faisant cela tu entasseras des charbons de feu sur sa tête » (Rom. 12:20).
Il y a deux ans environ, un fermier chrétien nommé Tung, habitant la Mandchourie, fut attaqué une nuit dans sa maison par une bande de brigands. Ceux-ci le lièrent avec des cordes, lui prirent tout ce qu’il possédait et mirent le feu à sa demeure. Quoiqu’il souffrît intensément, il supporta toutes les tortures morales et physiques dans un esprit de douceur chrétienne et n’adressa aucune plainte aux autorités.
L’année passée, se trouvant en ville, il rencontra un homme malade qu’il reconnut aussitôt pour un des chefs de la bande de bandits qui l’avaient assailli. Celui-ci l’avait reconnu aussi, et il se couvrit précipitamment la figure de son manteau, espérant échapper à l’attention de sa victime.
— Ne faites pas cela, dit M. Tung, je ne suis pas votre ennemi.
En entendant ces paroles, le brigand tomba à genoux et implora la pitié de celui qu’il avait maltraité.
— Que vous est-il arrivé ? répliqua Tung. Je vous ai dit que je ne suis pas votre ennemi. Racontez-moi ce qui s’est passé.
— L’hiver dernier, répondit le brigand, notre bande a été chassée par les soldats du gouvernement dans le désert de Mandchourie. Nous avons perdu notre route. Il faisait excessivement froid : nous avons marché toute la nuit et mes pieds étaient gelés quand nous sommes arrivés ici à l’auberge. Voilà deux mois que j’y suis, le montant de ma note est très élevé, je n’ai pas d’autres vêtements que ceux que je porte et je suis sur le point de périr.
Tung tira sa bourse et lui tendit 5000 cash (monnaie chinoise) en disant :
— Allez payer votre dette et vous procurer quelque chose à manger. Demain je viendrai vous chercher pour vous faire soigner à l’hôpital.
Le brigand supposa aussitôt que M. Tung lui tendait un piège pour le livrer à la police. Il retourna à l’auberge et passa une nuit sans sommeil à réfléchir à toute l’affaire. Il arriva à la conclusion qu’il devait s’enfuir, mais hélas ! ses pieds enflés ne le lui permettaient pas.
Le jour suivant, fidèle à sa promesse, Tung arriva avec une voiture et persuada au bandit de se laisser emmener à l’hôpital où il paya lui-même toute la dépense. Dans son coeur il pensait : « Il y entendra l’évangile et peut-être sera-t-il converti ».
Tant de bontés touchèrent le pauvre malade qui fondit en larmes en s’écriant :
— Je n’ai jamais vu un homme agir ainsi ; la religion de Jésus Christ seule peut inspirer de tels sentiments de compassion. Pareille chose ne s’est jamais vue en Chine auparavant. Je ne veux pas mourir. Je veux me confier en JÉSUS.
Et le bandit repentant ne mourut pas en effet. Il sortit de l’hôpital guéri dans son corps et dans son âme. Tung dut dépenser plus de vingt dollars pour couvrir ses frais, mais il y a aujourd’hui un serviteur de Dieu de plus en Mandchourie.
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent » (Matthieu 5:44).
Il y a quelque temps, lorsque les missionnaires étaient expulsés de la Chine centrale, une dame norvégienne vint se réfugier dans la maison où nous passions l’hiver. C’était une personne douce et tranquille, et que l’on aurait jugée à première vue incapable de grands exploits. Un soir cependant elle me raconta quelques-unes des circonstances de sa vie où elle avait eu à souffrir pour le nom du Seigneur.
Il lui était arrivé une fois d’être la seule étrangère dans une grande ville. Les Chinois se tournèrent contre elle et lui enjoignirent de s’en aller immédiatement.
— Très bien, répliqua-t-elle, je partirai demain matin.
Elle ne savait où aller, ni comment voyager, mais elle était sûre que Dieu lui ouvrirait un chemin, aussi n’éprouvait-elle aucune frayeur. Elle se recommanda au Seigneur et Il ne l’abandonna pas. Tard dans la soirée une troupe de brigands fondit à l’improviste sur la ville. Ils tuèrent quelques habitants, détruisirent plusieurs maisons, et emportèrent un grand butin.
Quand le matin arriva, la ville présentait un aspect de désolation. Au lieu de chasser l’étrangère, les Chinois se pressaient en foule à la porte de sa maison, lui demandant de panser leurs blessures. Mon amie n’était pas médecin, ni même infirmière, mais elle avait quelques notions des soins à donner, et surtout du courage et du bon sens, et par dessus tout de la foi. Elle se mit au travail et pansa les plus terribles blessures ; elle se vit même obligée parfois d’extraire une balle avec son canif. Comme vous pouvez le deviner, il ne fut plus question de la renvoyer de la ville. Je dois ajouter que quelques-uns de ses patients étaient des brigands qui avaient reçu des blessures trop graves pour pouvoir s’échapper avec le reste de la bande.
Plusieurs années se passèrent. Quelques missionnaires avaient rejoint notre amie, l’Évangile était annoncé et il s’était trouvé bien des coeurs pour le recevoir dans cette ville autrefois si hostile.
Notre amie était allée visiter une autre station missionnaire à une petite distance de là. Après quelques semaines de séjour, elle jugea qu’il était temps de rentrer, mais ses amis n’aimaient pas la laisser repartir seule.
— La contrée est infestée de brigands, lui dirent-ils, il n’est pas prudent de voyager sans une escorte de soldats.
Mais elle était décidée à partir et se mît en route en chaise à porteurs. Le premier jour il n’y eut aucun incident, et elle s’arrêta pour la nuit dans une auberge chinoise avec son escorte. Le lendemain matin ils partirent de bonne heure, espérant arriver à leur destination pour le dîner.
Soudain ils entendirent des cris stridents, et plusieurs hommes à l’air menaçant s’élancèrent sur eux. Ils ordonnèrent aux porteurs de poser la chaise, et ceux-ci, terrifiés, obéirent aussitôt. Les brigands, entourant la petite troupe de voyageurs, commandèrent à la dame de leur donner son argent et tout ce qu’elle possédait. Quand ce fut fait, ils dirent :
— Vous pouvez continuer votre chemin à présent.
Les deux porteurs étaient si effrayés que ce fut avec des mains tremblantes qu’ils soulevèrent leur fardeau.
— Dépêchez-vous, s’écria notre amie, la ville est déjà en vue.
Mais les pauvres gens étaient si bouleversés qu’ils étaient incapables de marcher vite, et un instant après les bandits les interpellaient de nouveau :
— La dame s’est-elle trouvée mal ? demandèrent-ils.
— Non, répondirent les hommes.
— Alors apportez-la ici.
Les porteurs obéirent.
— N’avez-vous pas peur ? demandèrent les brigands, en la faisant sortir de sa chaise.
— Non, répondit-elle tranquillement, et en me racontant cette histoire elle ajouta : « Et c’était vrai, je n’étais pas effrayée ; la paix de Dieu remplissait à tel point mon coeur qu’il n’y avait plus de place pour la peur, quoique je ne susse pas du tout ce que ces méchants hommes allaient faire de moi ».
— Savez-vous chanter ? fut la question inattendue.
— Oui.
— Alors chantez-nous quelque chose.
Elle était une faible femme au milieu d’une centaine d’hommes farouches et méchants pour lesquels un meurtre n’était rien. Mais cette pensée lui vint : « C’est peut-être la dernière fois que je puis rendre témoignage à l’amour de Christ ; que chanterai-je pour en faire connaître quelque chose à ces pauvres païens ? »
Elle n’hésita qu’un instant, puis sa voix s’éleva au-dessus des rochers et des collines tandis qu’elle chantait l’amour de Dieu et ce que son Fils a fait pour nous. Lorsqu’elle eut fini, il y eut un moment de silence, puis on lui demanda un autre cantique, puis encore un autre. Elle leur chanta ainsi tout son répertoire, et je ne sais combien de temps cela aurait duré, ni si on l’aurait jamais laissée partir libre, mais tout à coup survint un jeune homme à cheval qui paraissait le chef de la bande. Il regarda attentivement la prisonnière, puis, s’adressant à elle par son nom, il lui demanda où elle allait. Elle lui désigna la ville qu’on apercevait dans le lointain, et il enjoignit aussitôt aux porteurs de l’y conduire. Puis, se tournant vers ses hommes, il s’informa s’ils lui avaient pris quelque chose. Ils assurèrent que non.
— Alors partez tout de suite, dit-il, puis il ajouta : Peut-être ne me reconnaissez-vous pas, mais moi je vous connais bien.
Vous pouvez vous représenter avec quelle joie et quel soulagement notre amie remonta dans sa chaise, et combien elle était reconnaissante envers Dieu pour sa protection. Peu de temps après elle se trouvait de retour au milieu de ses amis, très intéressés par son récit.
— Ce doit être un des brigands que vous avez soignés autrefois, lui dirent-ils.
Mais une surprise lui était réservée. Après avoir pris le repos dont elle avait grand besoin, elle descendit dîner, et que pensez-vous qu’elle trouva sur la table ? Tous les objets que les voleurs lui avaient pris : argent, vêtements, ils avaient tout renvoyé.
N’y avait-il pas là un accomplissement de cette promesse :
« Invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras » (Ps. 50:15) ?
Il y a quelques années, deux serviteurs de Dieu, nommés Mo et Li, voyageaient ensemble dans une contrée montagneuse près de la ville de Ho T’au (ce qui signifie « Source du fleuve »). Sur leur chemin ils prêchaient l’Évangile dans les villages et les maisons isolées. Ils distribuaient des traités aux gens qu’ils rencontraient ou donnaient des images à ceux qui ne savaient pas lire ; ils vendaient pour un prix modique de petits exemplaires de l’un des quatre évangiles à quiconque était disposé à les acheter.
Ils avaient marché toute la matinée, mais dans l’après-midi les villages se firent plus rares, les collines devinrent plus escarpées et le paysage leur parut plus grandiose.
À la fin ils ne virent plus aucune maison, le sentier même disparut entièrement, et nos deux amis durent se laisser glisser en bas de la colline, enlever leurs sandales, retrousser leurs pantalons et suivre le lit de la rivière.
Au bout d’un moment, ils trouvèrent un gué et purent traverser sans peine le cours d’eau. En atteignant l’autre bord ils aperçurent un homme qui se tenait immobile sur le sable et paraissait les surveiller. Ils se dirigèrent aussitôt de son côté, lui offrirent quelques traités et lui demandèrent s’il voulait acheter un évangile.
Il ne répondit pas, mais soudain M. Li remarqua que son compagnon changeait de couleur et se mettait à trembler et, avant même d’avoir vu le grand fusil que l’homme venait de sortir de dessous son manteau, il avait compris qu’ils étaient tombés entre les mains des brigands ! En observant l’expression cruelle et méchante de cet homme, expression telle qu’il n’en avait jamais vu de semblable auparavant, M. Li fit monter vers Dieu une silencieuse prière pour lui demander que, si telle était sa volonté, Il envoyât son ange pour les délivrer.
En Chine les brigands sont, pour la plupart, des hommes pour lesquels un meurtre ou un vol ne sont rien, des hommes qui ignorent ce que c’est que la pitié.
Celui-ci se mit à questionner les deux chrétiens et, pendant ce temps, ils virent plusieurs individus du même genre, tous armés de fusils, sortir sans bruit de la forêt, et, peu d’instants plus tard, ils étaient complètement entourés par les brigands.
M. Mo et M. Li portaient chacun sur l’épaule un sac contenant leurs livres, traités, etc. Ces sacs furent soigneusement fouillés, et lorsque M. Li les pria d’avoir soin de sa vieille petite Bible parce qu’elle était précieuse, ils la saisirent avidement, mais furent tout aussi prompts à la jeter sous leurs pieds quand ils virent de quoi il s’agissait.
Puis on leur demanda leurs cartes. En Chine, chacun a l’habitude de porter sur soi ce que nous appellerions « des cartes de visite ». M. Mo n’en possédait pas, mais M. Li en avait dans son portefeuille avec une certaine somme d’argent, car il avait un long voyage devant lui.
Après le premier moment de frayeur, Dieu avait accordé aux deux amis un grand calme. M. Li ne dit rien et n’essaya pas de sortir son portefeuille, mais M. Mo répondit tranquillement qu’il n’avait pas de carte sur lui et ajouta :
— Mais j’ai la carte d’un de mes amis qui m’a dit que je rencontrerais peut-être une de ses connaissances dans ces parages.
Tout en parlant, il tendait en effet une carte au chef des brigands. Un nom y était imprimé en gros caractères et, à côté, on lisait la situation officielle du propriétaire. Sur le verso se trouvaient quelques lignes écrites à la main.
Le brigand, étonné, prit la carte et ses compagnons se groupèrent autour de lui pour la regarder. Ils l’examinèrent longuement, la lisant et la relisant plusieurs fois. Puis ils se consultèrent un moment à voix basse, et le chef demanda brusquement :
— D’où avez-vous cette carte ?
— Une de mes connaissances me l’a donnée et m’a dit que je serais sûr de recevoir aide et protection de la part de celui de ses amis auquel je la montrerais, quel qu’il soit. Nous nous rendons au prochain village. Ne voulez-vous pas nous accompagner avec vos fusils pour nous protéger au cas où nous ferions quelque mauvaise rencontre ?
— Non, répliqua le chef ; nous avons à faire d’un autre côté ; vous pouvez aller.
Puis il ordonna à ses hommes de rendre tous les livres et traités dont ils s’étaient emparés, et aussitôt après la bande se dispersa dans les bois. Nos amis se hâtèrent de revenir sur leurs pas, et poussèrent un soupir de soulagement lorsqu’ils retrouvèrent le bac qui les ramena dans une région sûre ; mais cela les amusa de constater l’étonnement de la vieille femme qui manoeuvrait l’embarcation lorsqu’elle leur demanda :
— Comment donc avez-vous fait pour revenir sains et saufs d’une contrée pareille ?
Cependant elle ne les avait aucunement avertis du danger qu’ils couraient lorsqu’elle les avait fait traverser ce même cours d’eau quelques heures auparavant.
Peut-être quelques-uns de mes lecteurs voyagent-ils sur une route encore bien plus dangereuse, guettés par un ennemi encore beaucoup plus terrible qui cherche à les saisir pour les entraîner dans l’étang de feu pour l’éternité. S’il en est ainsi, soyez avertis maintenant de « fuir la colère à venir ».
Mais vous demanderez : « Quelle était donc la carte magique qui sauva ces deux hommes ? » Je vais vous l’expliquer. Deux jours auparavant, M. Mo voyageant seul dans une autre direction, avait rencontré un officier supérieur et lui avait donné quelques traités. Celui-ci avait témoigné à M. Mo de l’intérêt et même de la sympathie, mais avait été étonné d’apprendre qu’il voyageait seul et sans armes dans une contrée aussi dangereuse ; aussi lui avait-il remis sa carte avec un mot de recommandation au verso en lui disant :
— Si vous rencontrez soit des soldats, soit des brigands qui veuillent vous faire du mal, montrez-leur cette carte.
Cet homme était le commandant des soldats du district, et son frère était le chef des brigands ! Ainsi ils travaillaient ensemble ! M. Mo avait pris toute l’affaire comme une plaisanterie, et n’avait pas pensé utiliser la carte. Cependant par bonheur il l’avait dans sa poche, et c’est ainsi que Dieu prit soin de ses serviteurs.
M. Mo a continué à travailler dans cette contrée depuis lors, au milieu de dangers et de difficultés multiples. Il y a beaucoup, beaucoup d’autres serviteurs de Dieu en Chine qui affrontent journellement des périls dont vous ne vous faites aucune idée.
N’est-ce pas un privilège pour ceux qui connaissent et qui aiment le Seigneur Jésus de prier pour tous ces serviteurs — membres du corps de Christ ? Il est dit : « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor. 12:26).
« L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre » (Ps. 34:7).
Je pense que la plupart de mes lecteurs savent qu’en Chine il n’y a pas un alphabet comme en France. Vous, mes enfants, vous n’avez besoin que de connaître les vingt-six lettres qui le composent, d’apprendre comment on les assemble, et ensuite vous savez lire. Mais en Chine, c’est très différent. Les petits enfants n’ont pas d’alphabet, mais chaque mot est représenté par un dessin particulier, et ainsi chacun doit être appris séparément. C’est terriblement difficile pour quelques-uns d’entre nous qui ne sommes plus jeunes : nous découvrons que nous oublions tous ces mots beaucoup plus vite que nous ne les apprenons. Si vous désirez venir travailler en Chine, n’attendez pas d’être trop âgés pour apprendre à lire et à écrire la langue du pays et, par dessus tout, à vous exprimer correctement.
Mais je veux vous parler un peu des caractères chinois. Je vous
ai dit que chaque mot a un petit dessin exprès pour lui. Par exemple, le mot homme s’écrit comme ceci : ![]() .
Ces deux traits sont ses deux jambes, et ainsi vous pouvez faire un petit
dessin de deux jambes, et cela signifiera un homme.
.
Ces deux traits sont ses deux jambes, et ainsi vous pouvez faire un petit
dessin de deux jambes, et cela signifiera un homme.
Le nom chinois de ce livre est ![]() . Cela signifie « Histoires de l’Empire
du milieu ». Le premier mot veut dire « Milieu ». Le carré
. Cela signifie « Histoires de l’Empire
du milieu ». Le premier mot veut dire « Milieu ». Le carré ![]() signifie bouche ; mais si l’on trace un
trait au milieu du carré, il ne veut plus dire bouche, mais milieu
signifie bouche ; mais si l’on trace un
trait au milieu du carré, il ne veut plus dire bouche, mais milieu ![]() .
.
Tous les mots chinois ne sont pas aussi faciles à comprendre que ceux-ci. Quelquefois on ne sait pas pourquoi ils sont représentés par tel ou tel dessin, mais d’autres ont une signification très belle. Je voudrais vous parler de quelques-uns de ces mots et de leur sens et j’espère que vous trouverez autant de plaisir que moi à y penser. J’espère aussi que les leçons qu’ils nous enseigneront pénétreront profondément dans nos coeurs, et porteront du fruit pour le Seigneur Jésus.
Avant de parler des mots, peut-être aimeriez-vous savoir comment les petits Chinois apprennent à écrire. Ils ne se servent généralement pas de crayons ni de plumes, mais d’une sorte de pinceau. Un de mes amis a écrit les mots que vous voyez dans ce livre ; puis un autre homme a collé le papier sur un morceau de bois et a creusé chaque petit trait ; enfin l’imprimeur a employé ce morceau de bois gravé pour reproduire les mots.
Leur encre n’est pas dans des bouteilles, mais se présente sous la forme de petites plaques dures ressemblant à des dominos, seulement deux fois plus longs. Elle est très noire, et avant de commencer à écrire, ils doivent mettre un peu d’eau dans un godet, et y frotter leur morceau d’encre jusqu’à ce qu’ils en aient assez. Vous voyez qu’il s’agit plutôt de peindre que d’écrire comme nous le faisons.
Leurs lettres sont toujours d’un beau noir, mais j’ai pris la liberté d’en faire une partie en blanc, pour vous aider à comprendre la leçon qu’elles renferment.

Ce dessin en tête de notre chapitre s’appelle en chinois « tsui ». On le prononce différemment dans les diverses contrées du pays, et c’est une des raisons pour lesquelles il est très difficile de prêcher l’évangile en Chine, parce qu’un habitant du sud ne comprend pas un habitant du nord. Quelque étrange que cela paraisse, il arrive parfois que l’on voie deux Chinois s’entretenir en anglais, parce qu’ils ne peuvent comprendre le langage l’un de l’autre. Dans certaines régions, les dialectes sont si mauvais que deux personnes ne vivant qu’à soixante kilomètres à peine l’une de l’autre ne peuvent se comprendre.
Mais je voudrais vous parler de ce caractère « tsui ». Il signifie péché. Je vous ai dit que plusieurs des caractères chinois sont des sortes de petites images qui indiquent le sens du mot, et c’est le cas pour celui-ci. La partie supérieure représente un filet de pêche. Vous pouvez voir les petits carrés qui figurent les mailles. La partie inférieure signifie le mal ou « méchant », et on peut considérer le tout comme représentant « Le filet du diable ». Quelques-uns d’entre vous vivent peut-être au bord de la mer et ont vu des filets de pêche faits de solides cordelettes : chacune d’elles si petite par elle-même que nous penserions qu’elle ne peut faire aucun mal. Peut-être avez-vous même été dans un bateau pour aider à retirer ces filets avec les pauvres poissons fermement retenus dans les mailles. Combien leur situation paraît désespérée ! Plus ils se débattent, et plus ils s’embarrassent dans le réseau meurtrier. À moins que quelqu’un du dehors, plus fort et plus puissant qu’eux, ne vienne les délivrer, ils sont immanquablement destinés à mourir. Quel triste spectacle que celui d’un poisson pris dans un filet ! Et quelle image merveilleusement vraie de l’état d’un pauvre pécheur pris dans le terrible filet du péché ! Assurément les Chinois ont eu raison de dessiner un filet de pêche pour représenter le péché.
Si vous avez jamais été au bord de la mer, vous devez savoir qu’il y a une quantité de filets différents. Il y en a de grands pour attraper les gros poissons et de petits pour les petits poissons. Il y en a qui sont faits de fine ficelle, et d’autres de grosse corde. Il y a des filets de toutes les formes et de toutes les grandeurs, mais ils ont tous le même but : attraper les poissons.
De même Satan a différentes sortes de péchés. Il y en a que nous jugeons de petits péchés, d’autres que nous jugeons de grands péchés : mais ils ont tous le même but — nous saisir et nous entraîner en enfer. Le pêcheur ne tend pas ses filets parce qu’il aime les poissons : et ce n’est pas non plus parce qu’il vous aime que le diable cherche à vous embarrasser dans le péché, mais parce qu’il voudrait vous entraîner avec lui dans les souffrances éternelles.
Je me demande si mes lecteurs ont jamais compris qu’ils avaient été pris dans ce terrible filet du péché ?
Je me demande s’ils ont jamais réalisé qu’ils étaient absolument impuissants et que leur condition était désespérée à moins qu’un Autre ne vienne les délivrer de ce piège effrayant ? Oui, la Parole de Dieu nous dit que « tous ont péché » ; il n’y a pas un homme, pas une femme, pas un petit garçon, pas une petite fille qui n’ait été pris dans ce funeste filet. Vous avez dit des mensonges, vous avez été désobéissants, désobligeants ; vous avez désiré ce qui n’était pas à vous, et vous avez commis beaucoup, beaucoup d’autres péchés, mais avant tous les autres il y a un péché dont Dieu parle spécialement : « Il convaincra le monde de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi », dit le Seigneur Jésus. Oui, si vous n’avez pas cru au Seigneur Jésus Christ comme à votre Sauveur personnel, c’est le plus terrible péché de tous. Si vous êtes coupable de ce péché, vous êtes sur le chemin de l’enfer et personne ne sait combien de temps il vous reste à vivre ici-bas. Puisse le Saint Esprit vous convaincre bientôt de ce péché, vous montrant que vous êtes aussi impuissant que le pauvre poisson pris dans le filet et que votre condition est aussi désespérée que la sienne. Mais puisse-t-il vous enseigner aussi qu’un Autre, le Seigneur Jésus lui-même, est venu rompre le filet qui vous tenait captif, et la seule chose que vous ayez à faire maintenant est de le croire pour être délivré.

Vous savez tous qu’après le péché vient la punition. Quelquefois à l’école vous n’êtes pas découvert : le maître ne vous voit pas. Quelquefois un voleur s’enfuit et la police ne réussit pas à remettre la main sur lui : et ainsi tous deux, l’enfant et le voleur, échappent au châtiment qu’ils ont mérité. Mais y échappent-ils vraiment ? Dieu a vu le petit garçon ou la fillette commettre la mauvaise action que le maître n’a pas vue. Le voleur aura un jour à comparaître devant Dieu et à rendre compte de son péché, à moins que quelqu’un d’autre n’ait été puni à sa place.
Si vous avez lu le chapitre précédent, vous reconnaîtrez tout de suite que la partie supérieure du caractère qui signifie « punition » est la même que celle du « péché ». Toutes deux représentent un filet de pêche. Mais lorsqu’il s’agissait du péché, c’était le filet du diable pour nous prendre et nous entraîner avec lui dans l’étang de feu. Ce filet-ci pourrait s’appeler le filet du maître qui surprend les petits garçons ou les petites filles à l’école, lorsqu’ils sont méchants. Ou bien cela pourrait être le filet du gendarme qui capture ceux qui ont enfreint les lois du pays : mais finalement c’est toujours le filet de Dieu qui amène tout être humain, homme, femme ou enfant à se tenir devant Lui. Si nous venons maintenant en sa présence comme de pauvres pécheurs perdus, nous trouverons qu’Il s’est pourvu de Quelqu’un pour subir le châtiment que nous avions mérité : c’est le Seigneur Jésus. Mais si nous ne répondons pas tout de suite à son appel, Il nous adresse cette question : « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? »
Qu’arrive-t-il lorsque vous avez été surpris à l’école faisant
quelque chose de mal ? Ou qu’arrive-t-il au voleur lorsqu’il a été
appréhendé par le gendarme ? « Oh ! alors vient la punition »,
répondra l’un de vous. Mais ce n’est pas ce qui arrive tout de suite après. Le
voleur comparaîtra devant le juge, et là il sera jugé selon ce qu’il a fait —
selon ses oeuvres. L’enfant devra rendre compte de sa conduite à son maître, et
celui-ci le jugera. Ainsi dans notre mot punition,![]() la partie suivante est celle-ci,
la partie suivante est celle-ci, ![]() et la base,
et la base, ![]() signifie, « une bouche ». Les quatre
traits qui la surmontent sont les paroles qui sortent de la bouche. Quelle
terrible chose de réaliser que, si vous n’êtes pas délivré de ce filet du
péché, un jour vous, vous-même, devrez vous tenir devant le
grand trône blanc, et y être jugé d’après vos
oeuvres.
signifie, « une bouche ». Les quatre
traits qui la surmontent sont les paroles qui sortent de la bouche. Quelle
terrible chose de réaliser que, si vous n’êtes pas délivré de ce filet du
péché, un jour vous, vous-même, devrez vous tenir devant le
grand trône blanc, et y être jugé d’après vos
oeuvres.
Alors vos oreilles entendront les terribles paroles de la bouche de votre Juge, Celui de devant la face duquel la terre et le ciel s’enfuiront.
Peut-être pouvons-nous penser que les quatre mots sortant de la bouche, dans notre caractère, sont :
Le péché — « Les gages du péché, c’est la mort ».
La mort — « Après la mort, le jugement ».
Le jugement — « Il furent jugés… Et si quelqu’un n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l’étang de feu ».
L’étang de feu.
Notre caractère comprend encore une partie, à droite ![]() .
Elle signifie une épée.
.
Elle signifie une épée.
Et elle représente l’épée qui exécute la sentence de mort prononcée par le juge. Voilà comment les Chinois représentent la « punition ». « Pris, jugé, exécuté ».
À l’école, cela peut être une punition, une retenue, ou quelque chose de ce genre. D’après la loi du pays, cela peut aller jusqu’à la mort, — mais dans le jugement du grand trône blanc il n’y a qu’une sentence : la seconde mort, l’étang de feu.

Vous vous rappelez que nous avons parlé du péché qui est semblable à un filet qui nous saisit et nous retient captifs jusqu’à ce qu’un Autre vienne nous sauver. Aujourd’hui je voudrais vous parler de Celui qui est venu nous délivrer du terrible filet du péché dans lequel nous étions tombés. Oui, grâces à Dieu, Quelqu’un est venu nous sauver, et dans le premier chapitre du Nouveau Testament nous lisons :
« Tu appelleras son nom Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés ».
C’est précisément ce qu’il nous fallait, n’est-ce pas ? Un Sauveur ! Quelqu’un qui nous délivre de ce terrible filet dont les mailles nous enserrent et nous retiennent captifs.
Eh bien ! je voudrais que vous regardiez très attentivement le caractère qui est en tête de notre chapitre. Vous verrez qu’il est composé de deux parties. La partie supérieure signifie « brebis » ou « agneau » ; vous pouvez voir qu’il a deux cornes, quatre pattes et une queue, et la croix au milieu est son corps. La partie inférieure de ce caractère signifie « moi » ou « je ». Maintenant pouvez-vous deviner ce que veut dire le mot tout entier ?
« Moi » couvert par un « Agneau » ?
Si vous connaissez un Chinois dans la ville que vous habitez, vous pouvez l’interroger sur ce mot ; il vous dira probablement que c’est « ii », mais il aura de la peine à vous expliquer sa signification ; aussi vais-je essayer de le faire. Ce caractère signifie « justice », mais je crains que certains de mes petits lecteurs ne comprennent pas très bien ce mot. Il y a différentes sortes de justice. Il y a votre propre justice ; ce sont toutes les choses justes, les bonnes choses que vous faites pour essayer de gagner le ciel.
En Chine il y a des « Sociétés d’oeuvres justes » dont les membres cherchent à accomplir de bonnes actions pour parvenir au ciel. Ce sont nos propres justices. Ce sont les choses que nous aimons que les autres gens voient quand ils nous regardent, les choses que nous aimons à porter à l’extérieur comme des vêtements, tandis que nous gardons les mauvaises choses cachées là où personne ne peut les découvrir ; elles sont recouvertes par notre justice. N’en est-il pas ainsi ? Dieu nous parle de nos justices et dit qu’elles sont comme des vêtements que nous portons pour nous couvrir, — mais Il ajoute qu’elles sont comme « un vêtement souillé ». Vous n’aimez pas porter un vêtement sale, n’est-ce pas ? Nous hésitons à toucher des haillons malpropres, nous les brûlons, et c’est le seul sort qui leur convienne. Il en est exactement de même de notre propre justice, des meilleures actions que nous accomplissons.
Nos péchés sont comme un filet qui nous enserre et nous entraîne dans l’étang de feu, et notre justice est comme un vêtement souillé ! Dans quelle terrible condition nous nous trouvons ! Que pouvons-nous faire ?
Maintenant regardez encore une fois le caractère qui est en tête de notre chapitre. Que voyons-nous là ? Nous voyons en bas « moi », avec un « agneau » par dessus, me couvrant, pour ainsi dire. De qui nous parle cet agneau ? La plupart d’entre vous peuvent me répondre : Du Seigneur Jésus, « l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quelle belle leçon renferme ce mot ! C’est précisément ce dont nous avions besoin ! L’Agneau de Dieu venu ici-bas pour ôter mes péchés, pour me sauver du filet dans lequel j’étais pris sans espoir, et le même Agneau de Dieu pour me couvrir tout entier à la place des vêtements souillés de ma propre justice. Avec quelle joie je me dépouillerai de mes vêtements impurs pour être recouvert par l’Agneau de Dieu, pour être caché en Lui !
Mais regardez encore une fois notre figure, et vous verrez que rien ne peut « me » toucher, sans toucher d’abord « l’Agneau » qui est au-dessus. Et, chers enfants, quand je pense comment tout le jugement de Dieu dû à mes péchés a été porté par ce précieux Agneau, comment Il a enduré les coups que je méritais, comment toutes les vagues et tous les flots de la colère d’un Dieu saint ont passé sur Lui (tandis que je suis en sécurité en Lui), quand je pense à tout cela, combien mon coeur peut être reconnaissant et comme je puis Lui rendre grâce.
Lorsque nous nous souvenons que la justice est ce qui nous recouvre, que ce soit les vêtements souillés de notre propre justice, ou l’Agneau de Dieu qui est la justice de Dieu, nous pouvons voir avec quelle beauté ce caractère chinois nous parle d’une justice qui n’est pas la nôtre, mais celle d’un Autre, la justice même de Dieu.
Cher lecteur, possédez-vous cette justice de Dieu ? Êtes-vous couvert par l’Agneau de Dieu ? Lorsque Dieu vous regarde, vous voit-Il entièrement caché dans son Fils bien-aimé ? C’est là ce qu’Il vous offre. Il dit : « Maintenant, la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ » est offerte « envers tous et sur tous ceux qui croient ». Êtes-vous de ce nombre ?

Nous avons parlé de la justice, et nous avons vu que la justice de Dieu est offerte à tous. C’est une offre merveilleuse, faite par Dieu lui-même pour donner Sa justice, librement, sans oeuvres, à quiconque veut la recevoir, homme, femme ou enfant. Nous avons vu que la justice de Dieu est semblable à une robe ou à un manteau qui nous couvre, et que notre propre justice est comme un vêtement souillé. À la place de notre justice, Dieu nous offre la sienne, mais c’est seulement « sur tous ceux qui croient ».
Le caractère chinois qui est en tête de notre chapitre se lit « Chung » et signifie tous. C’est vraiment un mot merveilleux. La partie supérieure signifie Sang, la partie inférieure, Trois hommes, et l’ensemble représente donc trois hommes abrités par le sang. Voilà comment les Chinois écrivent Tous. Ces trois hommes nous font penser à « Tous ceux qui croient ». Ils ont cru que le jugement allait venir, et ils se sont réfugiés dans le seul lieu de sécurité, à l’abri du sang.
Vous vous souvenez de l’histoire de la première Pâque. Dieu avait dit qu’au milieu de la nuit Il passerait à travers le pays d’Égypte et frapperait tout premier-né dans chaque maison. Mais Il avait donné aux Israélites un moyen de salut. Il leur avait dit de prendre un agneau, de le tuer, de mettre son sang sur les deux poteaux et le linteau de la porte, et Il avait fait cette promesse : « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d’Égypte ».
Il n’y avait pas de différence si les habitants de la maison étaient bons ou méchants, s’il s’agissait des Égyptiens ou des Israélites, s’ils étaient blancs, jaunes ou noirs : tout cela n’avait rien à voir avec leur sécurité. Ce qui importait, c’était qu’ils fussent oui ou non abrités par le sang. Le pire pécheur parmi les Égyptiens était en sûreté cette nuit-là s’il avait mis le sang sur sa porte, et le meilleur des Israélites aurait perdu son premier-né s’il avait négligé d’obéir à l’ordre de l’Éternel.
Il ne suffisait pas de dire : « je crois que le jugement de Dieu va venir, et que le sang est le seul moyen de salut ». Non, il fallait mettre le sang sur sa propre porte. Et il n’y a aucun avantage à croire que le jugement va venir et que Christ est le seul Sauveur, si vous ne vous confiez pas en Lui pour vous-même et si vous n’êtes pas vous-même personnellement à l’abri du sang.

Dans les deux derniers chapitres, nous avons un peu parlé de ce verset de Romains 3 qui nous dit que « la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ est envers tous et sur tous ceux qui croient ». Nous nous sommes un peu occupés de la justice et de « Tous », dans cette expression « Tous ceux qui croient ». Maintenant nous allons considérer un peu le caractère « croire ».
Lorsque j’étais un petit garçon, je trouvais ce mot « croire » très difficile à comprendre. Je me demandais à moi-même : « Qu’est-ce que croire ? » « Est-ce que je crois ? » et toutes sortes de questions semblables. Je pense qu’il y a encore aujourd’hui des personnes qui désirent posséder cette justice de Dieu qui est sur tous ceux qui croient, mais ils ne savent pas exactement comment faire pour l’obtenir : et j’espère que le caractère chinois qui se trouve au haut de cette page pourra peut-être leur aider.
À gauche se trouvent les deux traits qui signifient « homme ». Ils sont faits un peu différemment que dans le caractère que nous avons déjà vu, mais en réalité c’est exactement le même mot. Quant à la partie de droite, vous pouvez la reconnaître vous-même si vous avez lu les chapitres précédents. En bas, vous voyez le caractère signifiant « bouche », et au-dessus quatre traits représentant les paroles sortant de la bouche. On peut donc dire que le caractère tout entier signifie : « Les paroles qui sortent de la bouche d’un homme ». C’est ainsi que les Chinois écrivent « Croire » ou « Foi ». Et c’est une très bonne manière de faire. Je ne connais qu’une façon de l’écrire qui aurait été encore meilleure, ce serait : « Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ».
Je suppose que vous connaissez un homme en qui vous avez une absolue confiance. Peut-être est-ce votre père, ou votre frère, ou quelqu’un d’autre. S’il vous dit quelque chose, vous pouvez affirmer : « Je sais que c’est vrai ». Vous croyez les paroles qui sortent de la bouche d’un homme. C’est la foi. Vous croyez les paroles, non parce qu’elles vous semblent vraies, mais parce que vous avez confiance en l’homme qui les a dites. Il peut y avoir d’autres personnes dont vous ne croyez pas les paroles. Peut-être est-ce pour plaisanter qu’elles disent ce qui n’est pas tout à fait vrai, ou bien ont-elles l’habitude d’exagérer, ou de mentir : mais, quoi qu’il en soit, vous regardez à la personne qui vous parle et vous dites : « Je ne puis pas croire ce que cette personne me dit ». Ce n’est pas que ses paroles ne puissent être vraies, mais on ne peut avoir confiance dans la personne qui les prononce.
Mais il ne s’agit pas toujours de paroles prononcées, quelquefois elles sont écrites. Par exemple, j’ai dans ma poche un billet sur lequel est écrit :
BANQUE DE FRANCE — CENT FRANCS
payables en espèces, à vue, au porteur.
Et au-dessous de cette promesse il y a deux signatures, l’une du Caissier principal, l’autre du Secrétaire général. Eh bien ! je suis absolument sûr que si je montre ce billet à qui que ce soit en France, on me l’échangera volontiers contre cent francs en monnaie. Je n’ai pas le moindre doute au sujet de ce papier, ni aucune crainte de ne pas recevoir mon argent. Je considère celui qui a promis, c’est-à-dire la Banque de France, et je dis : « Certainement je puis avoir confiance en cette promesse ». Je la crois. J’ai foi en elle.
Mais il y a quelque temps, j’ai eu entre les mains un autre billet sur lequel se trouvait la promesse d’un certain général chinois assurant qu’il payerait cinq dollars sur demande. Ce billet m’a donné passablement de peine et de souci. D’abord je ne croyais pas que le général eût l’argent nécessaire pour payer, et ensuite je ne savais pas s’il voudrait tenir sa promesse même s’il en possédait les moyens. J’essayais de croire, mais lorsque je pensais à la personne qui avait promis, je ne parvenais pas à avoir confiance. Je me rendis avec mon billet dans un bureau de change, comme il y en a beaucoup en Chine. Je montrai la Promesse, lisiblement écrite en noir sur blanc, mais les employés sourirent en secouant la tête. Je m’adressai encore à cinq autres établissements, mais sans avoir plus de chance. Je demandai : « Ne voulez-vous pas au moins me donner quelques sous en échange de mon billet ? » « Pas un seul, » me répondit-on. Le billet ne valait même pas le papier sur lequel il était imprimé.
La Bible me dit : « La foi est de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la Parole de Dieu ». Dieu fait une promesse. Peut-Il la tenir ? Vous savez qu’Il le peut. Veut-Il la tenir ? Vous savez qu’Il le veut : Il ne peut mentir. Il ne manquera jamais à sa promesse. Elle vaut mieux que la promesse de la Banque de France. Lorsque vous regardez à Celui qui a promis, pouvez-vous LE croire ? Ne devrais-je pas plutôt demander : « Est-il possible que vous doutiez de Lui ? »
Voici une de ses promesses : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ». Le croyez-vous ? Je reconnais que ce serait incroyable, si ce n’était pas DIEU qui le disait. Mais regardez à Celui qui a promis. Regardez à CHRIST, Il dit : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ». Le prenez-vous au mot ? Croyez-vous au Fils ? Croyez-vous que le Fils de Dieu a porté vos péchés sur la croix du Calvaire ?
Abandonnez-vous toutes vos bonnes oeuvres et les différentes choses dans lesquelles vous avez mis votre confiance jusqu’ici, et vous écriez-vous comme un de mes amis l’a fait une fois : « Si la Bible est vraie, je suis perdu » ? Vous tournez-vous vers Christ seul, et vous confiez-vous en Lui seul ? Alors les paroles qui sortent pour vous de la bouche de Dieu sont : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ». Prenez ces paroles pour vous et reposez-vous entièrement sur elles. Vous pourrez dire alors comme un autre l’a fait : « Si la Bible est vraie, je suis sauvé ».
Dieu soit béni, la Bible est vraie. « Que DIEU soit vrai et tout homme menteur ». Vous pouvez vous reposer sur les paroles de ce Livre avec plus de confiance que je ne le fais sur la promesse de la Banque de France. La France peut faire faillite et disparaître, mais les paroles de ce Livre demeureront à toujours. Regardez à Celui qui les a prononcées, croyez Dieu, et remerciez-le pour une telle promesse et pour un tel don.
« Le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur ».

Dans notre dernière causerie, nous avons dit que le Fils de Dieu a porté nos péchés sur la croix du Calvaire. Et si nous regardons ce caractère chinois, nous y voyons le dessin de cette croix. Lorsque Moïse s’approcha du buisson ardent, une voix lui dit d’ôter ses sandales de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tenait était une terre sainte. Ce caractère chinois nous conduit sur une terre sainte, puissions-nous, vous et moi, savoir ce que c’est que d’enlever nos sandales de nos pieds.
Vous vous souvenez comment les Chinois écrivent « homme »,
![]() ,
avec deux traits. Sur cette croix qui est devant vous, il y a un Homme. Nous
n’avons pas besoin de demander : « Qui est-il ? » De chaque
côté de la croix nous voyons un autre homme, et cela nous rappelle ce verset :
« Ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et
Jésus au milieu ».
,
avec deux traits. Sur cette croix qui est devant vous, il y a un Homme. Nous
n’avons pas besoin de demander : « Qui est-il ? » De chaque
côté de la croix nous voyons un autre homme, et cela nous rappelle ce verset :
« Ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et
Jésus au milieu ».
Sur notre figure, j’ai demandé à l’écrivain chinois de faire l’un des hommes en blanc et de laisser l’autre en noir (d’habitude le mot tout entier est noir). Je suis sûr que vous connaissez tous l’histoire. Les deux brigands L’injurièrent, puis l’un reprit son compagnon, disant : « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es, sous le même jugement ? Et pour nous, nous y sommes justement ; car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises : mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire ». Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus lui dit : « En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ».
Les deux brigands étaient noirs de péché. Tous deux méritaient d’être crucifiés. L’un n’était pas le moins du monde meilleur que l’autre. Tous deux injurièrent le Sauveur. Quelle était alors la différence entre eux ? L’un comprit qu’il était un pécheur et le reconnut. Il confessa Jésus comme SEIGNEUR. Cet Homme mourant sur la croix était Seigneur pour le pauvre brigand pécheur. Il vint à Jésus. Ah ! direz-vous, il était cloué sur la croix, il ne pouvait venir à Jésus. Oui, quoique cloué sur la croix, il vint à Jésus. Je pensais autrefois : « Oh ! si seulement Jésus vivait maintenant encore à Jérusalem, ou en Palestine, j’économiserais tout mon argent pour aller à Lui, je ferais un long voyage à pied s’il n’y avait pas d’autre moyen ». Il entendait des gens dire : « Venez à Jésus », et je pensais : « Oh ! si seulement je savais comment aller, j’irais volontiers ». Eh bien, le moyen d’aller est de faire comme le pauvre brigand. Il reconnut qu’il était un pécheur, et que Jésus était Seigneur. Je me souviens, que lorsque je compris que c’était là le moyen de venir, je dis presqu’à haute voix dans la réunion où je me trouvais : « Est-ce là tout ? » C’est tout, en effet. Il y a plus de trente ans de cela, et je n’ai jamais entendu parler d’un autre moyen de venir à Jésus. On peut l’expliquer avec d’autres mots, mais le chemin est le même.
« Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé » (Romains 10:9).
Mais considérons encore ce pauvre brigand sur la croix. Qu’arrive-t-il ? Dieu prend les péchés de ce méchant homme, et les met sur l’Homme qui est crucifié au milieu. Lui n’avait pas de péché, mais Il prend le péché de dessus le brigand et le porte tout entier en son corps sur le bois. Quel spectacle sur la colline du Calvaire ! D’un côté un brigand mourant, un homme trop méchant pour être laissé en vie plus longtemps, mais désormais n’ayant plus sur lui un seul péché l’empêchant d’entrer au ciel. Quelques minutes auparavant il était noir de péchés, mais maintenant il est lavé et plus blanc que la neige. De l’autre côté se trouve un autre brigand. Il n’est pas plus mauvais que son compagnon. Lui aussi va mourir : dans quelques heures son âme aura quitté la terre et sera où ? Oh ! combien c’est terrible ! Mourir en portant son péché comme un lourd fardeau qui l’entraînera en enfer. Celui-ci n’est pas venu à Jésus !
Lecteur, lequel de ces deux brigands est ton image ? Sûrement l’un des deux te représente. Il n’y a que deux classes d’hommes, — les sauvés et les non-sauvés : ceux qui portent leurs propres péchés et ceux dont les péchés sont portés par Christ. Dans quelle classe vous trouvez-vous ?
Voilà l’enseignement que me donne le mot chinois « Venez ».
Lorsque je vois ce mot ![]() ,
venez, je vois le Sauveur, avec ses
bras étendus sur la croix, étendus pour vous et étendus vers vous, et disant :
« Venez à Moi ». « Venez
à Moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous
donnerai du repos ». « Laissez venir à Moi les petits enfants ».
« Venez maintenant ».
,
venez, je vois le Sauveur, avec ses
bras étendus sur la croix, étendus pour vous et étendus vers vous, et disant :
« Venez à Moi ». « Venez
à Moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous
donnerai du repos ». « Laissez venir à Moi les petits enfants ».
« Venez maintenant ».
« Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Sauveur, et que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé ».
Venez comme le brigand l’a fait, comme un pécheur coupable et perdu, qui ne mérite que la mort, confessez Jésus comme votre Seigneur, et écoutez sa parole : « Tu seras sauvé ».
Tel que je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi,
Et ta voix qui m’appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens.
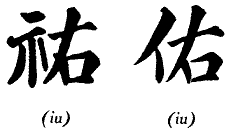
Nos caractères chinois nous ont enseigné quelque chose au sujet du péché ; ils nous ont parlé du Sauveur et de la justice dont Il revêt ceux qui ont placé leur confiance en l’Agneau de Dieu. Aujourd’hui je désire vous en dire un peu plus long au sujet de ce précieux Sauveur, mais je m’adresserai plus spécialement à ceux d’entre vous qui ont mis leur confiance en Lui et qui possèdent sa justice ; — car si vous n’avez pas cru que le Seigneur Jésus est mort pour vous et qu’Il a porté vos péchés sur la croix, je crains que vous ne croirez pas non plus ce que je chercherai à vous expliquer aujourd’hui.
Les deux caractères que nous avons devant nous se ressemblent quelque peu. La partie de droite de l’un et de l’autre est la même, ils se prononcent tous deux de la même façon, et tous deux signifient : « Protéger », mais en réalité il existe une grande différence entre eux. La partie de droite de l’un et l’autre caractère signifie « le bras droit », mais la partie de gauche du second signe signifie « l’homme », tandis que la partie correspondante de l’autre caractère peut être traduite par le mot « Dieu ». Quelle différence ! Le caractère de droite pourrait être exprimé ainsi : « Protégé par le bras droit de l’homme », et celui de gauche : « Protégé par le bras droit de Dieu ».
Maintenant je me demande quelle est la part de mon lecteur. C’est une chose merveilleuse de penser que l’on est protégé par la droite de Dieu, maintenant et pour l’éternité ! Connaissez-vous cette protection ? Ou peut-être ressemblez-vous à ce garçon de ma connaissance qui, ayant reçu un magnifique couteau de poche, négligea ce soir-là de dire sa prière. Sa mère lui demanda la raison de cette négligence. Il répondit :
— Un garçon qui a un si beau couteau n’a pas besoin de prier.
Vous voyez que ce garçon avait mis sa confiance dans le beau couteau « du bras droit de l’homme » pour le protéger. Ceci peut aider en quelque mesure pour ce qui regarde les choses d’ici-bas, mais qu’en sera-t-il lorsqu’il faudra rencontrer la mort, et après la mort, le jugement ? Et même pour ce qui concerne la terre, je pense que le petit garçon aurait été infiniment plus heureux sous la protection du « bras droit de Dieu ». N’êtes-vous pas de mon avis ?
Il est précieux de se souvenir que non seulement nous sommes mis à l’abri de la juste colère de Dieu contre notre péché, mais encore qu’Il nous a donné sa propre justice. Dieu nous a justifiés, mais ce n’est pas tout. Dans Rom. 8, nous lisons : « Ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
Oui, enfants, Dieu est pour nous. Vous savez que si nous jouons à un jeu quelconque, nous serons sûrs de gagner la partie si nous avons un très bon joueur de notre côté. Mais imaginez un instant ce que c’est que d’avoir pour nous le Dieu Tout-Puissant. N’est-ce pas merveilleux ? Ce n’est pas un bras de chair, un bras d’homme que nous avons avec nous pour nous protéger. Non, c’est le bras droit de Dieu. Dieu est pour nous. Et pourtant le Seigneur doit poser cette question : « À qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé ? » Cher lecteur, si vous ne l’avez pas vu jusqu’à présent, allez vous mettre à genoux et demandez-Lui de vous le faire connaître.
Il y avait une fois un bon roi qui s’appelait Ézéchias, et un puissant souverain venant d’Assyrie lui fit la guerre. Ézéchias n’avait que peu de force, et son adversaire crut qu’il le vaincrait facilement. Mais Ézéchias dit à son peuple : « Fortifiez-vous et soyez fermes ; ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d’Assyrie et à cause de toute la multitude qui est avec lui ; car avec nous il y a plus qu’avec lui ; avec lui est un bras de chair, mais avec nous est l’Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats ». Et le peuple s’appuya sur les paroles d’Ézéchias. Voici donc un homme auquel le bras de l’Éternel avait été révélé. Qu’en est-il de nous ?
J’ai toujours aimé ces paroles :
« Avec nous est l’Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats ». Mais peut-être les enfants qui lisent ces lignes diront-ils :
— Nous n’avons pas de bataille à livrer, nous sommes trop petits.
En effet, vous êtes très petits, mais si vous appartenez au Seigneur Jésus et si vous avez mis votre confiance en Lui, vous aurez des luttes à soutenir. Il est trois grands ennemis que vous devrez rencontrer, et ils sont tous terriblement forts. Leurs noms sont : « le monde, la chair et le diable », et tôt ou tard vous aurez à combattre contre eux. Si vous essayez de les vaincre par votre propre force, vous êtes absolument certains d’être défaits. Mais si vous avez le bras droit de Dieu qui combat pour vous et que vous le laissiez faire, vous remporterez très certainement la victoire. Si nous croyons au Seigneur Jésus Christ, nous trouvons en Lui le chef de notre salut, et croyez-moi, enfants, nous combattons sous les ordres d’un Chef qui n’a jamais perdu une bataille et qui n’en perdra jamais. Nous pouvons avoir en Lui une confiance absolue, et tout ce que nous avons à faire, c’est de Lui obéir en toutes choses.

Un de nos cantiques chinois favoris commence ainsi :

ou : « Le cœur de tout homme cherche le bonheur », ce qui est bien vrai.
Je crois que ![]() Fu est le caractère le plus commun et le
mieux connu en Chine. Vous le trouvez écrit sur les murs, en briques de
différentes couleurs, en inscriptions de près de deux mètres de haut. Au moment
du Nouvel An, les Chinois peignent ce mot sur de grandes feuilles de papier
rouge qu’ils collent sur leurs portes. On en fait aussi des garnitures de
broches et d’épingles ; et de fait, où que vous alliez, dans toutes les
contrées de la Chine, vous rencontrerez ce mot « Fu ».
Fu est le caractère le plus commun et le
mieux connu en Chine. Vous le trouvez écrit sur les murs, en briques de
différentes couleurs, en inscriptions de près de deux mètres de haut. Au moment
du Nouvel An, les Chinois peignent ce mot sur de grandes feuilles de papier
rouge qu’ils collent sur leurs portes. On en fait aussi des garnitures de
broches et d’épingles ; et de fait, où que vous alliez, dans toutes les
contrées de la Chine, vous rencontrerez ce mot « Fu ».
Pourquoi cela ? Parce que le coeur de chaque homme, femme ou enfant en Chine cherche ce dont parle ce caractère, le bonheur. Et, quant à cela, la Chine ne diffère pas des autres pays. En France ou en Suisse il en est exactement de même ; et, si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons tous que nous désirons être heureux.
Mais les uns cherchent le bonheur d’une manière, les autres d’une autre. Quelques-uns essayent de l’atteindre en prenant de la drogue ou en jouant pour de l’argent ; d’autres, en allant au cinéma ou au théâtre. Certains poursuivent la fortune ou le pouvoir ; mais le coeur reste toujours le même : où qu’on aille et quels que soient les moyens mis en oeuvre « le bonheur est ce que les hommes recherchent ».
Mais l’atteignent-ils ? S’ils sont honnêtes, ils doivent reconnaître qu’ils ne trouvent pas dans ces choses le véritable bonheur. Il y a eu un homme qui possédait tout ce que le monde peut donner et qui a dû s’écrier : « Vanité des vanités ! Tout est vanité ! »
Mais DIEU désire-t-il que nous soyons malheureux ? Non, certainement non, et Il dit : « Bienheureux l’homme dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert ». Tel est le moyen, et le seul moyen, par lequel un homme peut être réellement heureux ici-bas.
Le Seigneur Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos ».
Le mot Évangile en chinois signifie « Heureux son ». Dieu désire nous donner le Repos et le Bonheur, mais — c’est triste à dire — bien peu de gens croient en Lui, et les autres cherchent à atteindre ces choses par leurs propres moyens, non pas par celui que Dieu leur offre, et ainsi ils ne trouvent jamais à satisfaire leur coeur.
Mais je crois entendre certains de mes lecteurs dire : « Oui, tout cela est vrai. Je sais qu’il n’y a pas de vrai bonheur en dehors de Jésus Christ ; je suis venu à Lui, Il a pardonné ma transgression, Il a couvert mes péchés, Il m’a donné du repos, et cependant, — cependant je n’ai pas trouvé tout ce que j’espérais. Ce n’est pas le bonheur complet que j’attendais, ni le repos absolu dont j’avais besoin ».
C’est à ceux-là que je voudrais m’adresser maintenant. C’est pour eux que notre caractère chinois a un secret à dévoiler, car, quelque étrange que cela puisse paraître, bien loin, dans ce sombre pays de Chine, et caché dans le mot le plus commun de tous, se trouve le vrai secret du Bonheur pour le chrétien. Si vous n’êtes pas un vrai croyant, si vos péchés ne sont pas couverts, fermez ce livre et allez au Sauveur sans attendre un instant de plus. Ne lisez pas même la page suivante, car si cette première grande question de vos péchés n’est pas réglée, vous ne pourrez jamais comprendre ni croire le secret que renferme le mot Fu.
Et maintenant qu’il est bien entendu que je ne m’adresse qu’à des croyants, voulez-vous examiner attentivement avec moi le caractère qui est en tête de notre chapitre. Si vous vous souvenez des leçons précédentes, vous pourrez lire seul presque entièrement les différentes parties de Fu. À gauche est représenté un autel sur lequel se trouve un sacrifice. À droite on voit une bouche, ou, comme nous dirions un homme. Sous la bouche est dessiné un champ. Maintenant pouvez-vous deviner le secret ? Eh bien, ce caractère me fait penser à un verset de la Parole de Dieu : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent » (Rom. 12:1).
Ce n’est qu’en tant que je présente sur l’autel mon corps, moi-même, et tout ce que je possède, mes champs, ma maison, mon argent, mon tout, à Celui qui m’a racheté, que je puis être vraiment « Heureux ». Après avoir dit : « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos », le Seigneur Jésus ajoute : « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de coeur ; et vous trouverez le repos de vos âmes ». Voilà, cher lecteur, le repos auquel vous aspirez, mais le seul moyen de l’atteindre est de prendre « Son joug » sur vous, comme l’a dit le Sauveur. Qui porte un joug ? Le boeuf. Et que possède un boeuf ? Rien, pas même son propre corps qui appartient complètement à son maître. Un boeuf ne possède pas les champs dans lesquels il travaille ; ils sont la propriété de son maître. L’apôtre Paul pouvait parler de lui-même comme d’un « esclave de Jésus Christ ».
Que possède en propre un esclave ? Rien, pas même son corps, sur lequel son maître a tous les droits. La maison, les champs, tout appartient au maître, et la seule chose que l’esclave ait à faire, c’est d’obéir.
Voilà le secret, cher lecteur. Vous semble-t-il pénible ? Pour le chrétien, il n’y a de bonheur nulle part ailleurs. Et c’est un heureux, heureux chemin. Paul le suivait. Était-il malheureux ? Lisez l’épître aux Philippiens. Elle parle de joie d’un bout à l’autre. Je pense qu’il n’y a jamais eu un homme plus heureux que l’apôtre Paul ; et voyez comment, inspiré par l’Esprit de Dieu, il commente le verset 1 de Rom. 12:
« Et ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite » (Rom. 12:2). Oui, quand nous présentons nos corps en sacrifice vivant, il est saint, agréable à Dieu. Mais, après l’avoir fait, nous discernons quelle est la volonté de Dieu, bonne, et agréable, et parfaite. Alors nous éprouvons que présenter nos corps en sacrifice vivant n’est pas seulement agréable à Dieu, mais nous est agréable à nous aussi. Nous voyons alors que Sa volonté est parfaite, et qu’elle est bonne.
Cher lecteur croyant, il n’existe pas d’autre chemin heureux pour vous et moi, c’est notre service intelligent. Pourrions-nous faire moins ? Il nous a achetés au prix de son précieux sang. « Vous n’êtes pas à vous-mêmes ; car vous avez été achetés à prix ».